|

 n jour j’allois en Thessalie pour certaines affaires de famille. Un cheval me portoit, moi et mon bagage ; un valet me suivoit. Or, chemin faisant, je me trouvai avec quelques-uns de la ville d'Hypate, qui s’en retournoient au pays ; et marchant de compagnie, causant, mettant vivres en commun, nous nous entr’aidions à tromper l’ennui du voyage ; et comme nous fûmes près de la ville, je m’enquis d’eux s’ils connoissoient point Hipparque, un habitant de-là, pour qui j’avois des lettres de recommandation, comptant même loger chez lui ; ils me dirent qu’oui, qu’ils le connoissoient, que c’étoit un des riches du lieu, bien qu’il n’eût qu’une servante seule pour tout domestique, et sa femme ; car il est avare me dirent-ils, et vit chichement. A l’entrée de la ville un jardin clos de murs, une maison petite, mais jolie, c’étoit la demeure d’Hipparque, où me laissèrent mes compagnons. Nous nous embrassâmes. Eux partis, je frappe à la porte. Une femme à grand’peine me répondit de dedans, puis me vint ouvrir ; et sur ma demande, si le maître étoit au logis ; « Oui, fit-elle ; mais qui es-tu ? que lui veux-tu ? - Je lui veux, dis-je, rendre une lettre du sophiste Decrianus de Patras. – Attends », me dit-elle ; et fermant la porte, elle nous laisse dehors, et s’en va. Elle revint enfin. Introduit près d’Hipparque, je lui présente ma lettre en le saluant. Ils alloient souper à l’heure même, lui et sa femme, couchés sur un petit lit, seuls ; devant eux, une table non encore servie. Ayant lu la lettre : « Oh ! le brave homme, s’écria-t-il, que Decrianus ! Oui certes, il fait bien de m’adresser ses amis. Tu vois, Lucius, ajouta-t-il, ce que c’est que mon logis, une maisonnette peu digne de te recevoir, mais que j’estime un palais, si tu veux t’en contenter. » Cela dit, il appelle la servante : « Va, Palestre, donne à notre hôte une chambre et ce qu’il lui faut, et puis tu l’enverras au bain ; car ce n’est pas peu de fatigue qu’un pareil voyage. »
n jour j’allois en Thessalie pour certaines affaires de famille. Un cheval me portoit, moi et mon bagage ; un valet me suivoit. Or, chemin faisant, je me trouvai avec quelques-uns de la ville d'Hypate, qui s’en retournoient au pays ; et marchant de compagnie, causant, mettant vivres en commun, nous nous entr’aidions à tromper l’ennui du voyage ; et comme nous fûmes près de la ville, je m’enquis d’eux s’ils connoissoient point Hipparque, un habitant de-là, pour qui j’avois des lettres de recommandation, comptant même loger chez lui ; ils me dirent qu’oui, qu’ils le connoissoient, que c’étoit un des riches du lieu, bien qu’il n’eût qu’une servante seule pour tout domestique, et sa femme ; car il est avare me dirent-ils, et vit chichement. A l’entrée de la ville un jardin clos de murs, une maison petite, mais jolie, c’étoit la demeure d’Hipparque, où me laissèrent mes compagnons. Nous nous embrassâmes. Eux partis, je frappe à la porte. Une femme à grand’peine me répondit de dedans, puis me vint ouvrir ; et sur ma demande, si le maître étoit au logis ; « Oui, fit-elle ; mais qui es-tu ? que lui veux-tu ? - Je lui veux, dis-je, rendre une lettre du sophiste Decrianus de Patras. – Attends », me dit-elle ; et fermant la porte, elle nous laisse dehors, et s’en va. Elle revint enfin. Introduit près d’Hipparque, je lui présente ma lettre en le saluant. Ils alloient souper à l’heure même, lui et sa femme, couchés sur un petit lit, seuls ; devant eux, une table non encore servie. Ayant lu la lettre : « Oh ! le brave homme, s’écria-t-il, que Decrianus ! Oui certes, il fait bien de m’adresser ses amis. Tu vois, Lucius, ajouta-t-il, ce que c’est que mon logis, une maisonnette peu digne de te recevoir, mais que j’estime un palais, si tu veux t’en contenter. » Cela dit, il appelle la servante : « Va, Palestre, donne à notre hôte une chambre et ce qu’il lui faut, et puis tu l’enverras au bain ; car ce n’est pas peu de fatigue qu’un pareil voyage. »
La fille aussitôt nous conduit dans une petite chambre fort propre. « Toi, me dit-elle, voici ton lit ; et, en ce coin, j’arrangerai un matelas pour ton valet, avec un coussin. Lui ayant donné de quoi acheter de l’orge à mon cheval, nous sortîmes et allâmes au bain, pendant qu’elle serroit mon peu de bagues et d’équipages. De retour, nous entrons dans la salle, où me prenant par la main, Hipparque me fit mettre à table près de lui. La chère fut assez honnête, le vin bon. Quand on eut mangé, on se mit à boire, causant, pots sur table, jusqu’à ce qu’il fût l’heure de dormir. Le lendemain matin, Hipparque me demande où j’avois dessein d’aller ; si je ne ferois point quelque séjour en leur ville. « Je vais, dis-je, à Larisse, et compte partir d’ici dans quatre ou cinq jours. » Mais c’étoit feinte que cela ; j’y voulois trop bien demeurer, m’étant mis en tête de trouver quelque magicienne qui me pût faire voir de ces prodiges, comme un homme volant, ou bien changé en pierre. L’esprit plein de cette pensée, j’allois par la ville sans sçavoir trop comment m’y prendre ; mais j’allois, quand je me vois venir au devant une femme jeune encore, et riche, comme il paroissoit à son train et toute sa personne ; beaux habits, joyaux, riches atours, grande suite de gens et de valets. Plus proche, comme je la regardois, la voilà qui me salue par mon nom ; moi de le lui rendre au mieux que je sçus ; et elle me dit : « Je suis Abrœa, si tu ne connois l’amie de ta mère, qui tous vous aime ses enfans, comme ceux mêmes que j’ai mis au monde. Que ne viens-tu, mon fils, de ce pas chez moi demeurer ? - Grand merci, lui dis-je, c’est trop de grâce. Un ami, qui me reçut et me traite en sa maison, le quitter ainsi seroit injure. Mais de cœur et de volonté je demeure chez toi, noble dame, et ne t’en suis pas moins tenu. - Qui donc te loge ? reprit-elle. - Hipparque, dis-je. Cet avare ? - Ah, mère, ne parle pas ainsi d’un homme envers moi magnifique, et de qui chose ne me fâche, sinon le trop de chère qu’il me fait. » Lors, avec un sourire me tirant à l’écart : « Prends garde, me dit-elle, prends bien garde à sa femme ; c’est la plus grande sorcière qui soit en tout le pays. Libertine, elle en veut à tous les jeunes gens ; et, qui ne fait à sa guise, elle te les change en bêtes, ou de malemort les fait périr. Tu es jeune, mon enfant, bien fait de ta personne, et ne peux que tu ne lui plaises, étranger d’ailleurs de qui nul n’aura de souci. »
A ces paroles, connoissant que j’avois chez moi ce que je cherchois dehors, je ne l’écoute plus ; mais sitôt que je la pus quitter, je m’en revins tout courant, et me disois à part moi : « Or ça, voici l’occasion venue que tu as tant désirée, de voir des choses extraordinaires. Sus donc, alerte, Lucius ! tâche par quelque invention … La femme de ton hôte, tu dois la respecter ; mais fais tant que d’avoir la servante pour amie. En te jouant, fôlatrant avec elle, mais que tu lui viennes à gré, elle te dira tout. Chose ne se fait au logis que ne sçachent les valets. »
 Ainsi fantasiant, j’arrive à la maison, où se trouvoit de fortune, les maîtres étant sortis, Palestre seule occupée à préparer le souper. D’entrée, je l’aborde et lui dis : « Oh, que doucement tu remues, gentille Palestre, tes fesses ensemble et ta poële ! Que telle cuisine est friande, et heureux qui peut tremper un doigt en ta sauce. » Elle (car c’étoit la plus frisque et gente petite femelle !) me repart de bonne grâce : « Fuis, jeune homme, si tu es sage, et si tu veux vivre ; ma poële est ardente et mon brouet bouillant ; que si tu y touches tant seulement, jamais ne guérira de la brûlure. Et n’est physicien tant expert, qui te sçut alléger ce mal, fors moi seule, ce qui est de plus admirable, moi cause de ta douleur. Mais alors me criant merci, tu seras tout le jour après moi. Plus je te ferai souffrir, moins tu me voudras quitter ; non, tu ne t’en iras pas, quand je te jetterois des pierres, ayant éprouvé que c’est de la douceur de mon baume. Tu nourriras ta blessure ; toujours requérant médecine, jamais ne voudras guérison. Qu’as-tu à rire ? Sçais-tu bien que je fais cuisine d’hommes ? qu’autant que j’en prends, je les écorche comme beaux petits lapins, les désosse, les fricasse, n’épargnant foie ni courée ? - Je te crois, lui répondis-je ; car de t’avoir vue seulement, je suis déjà sur la braise. Ton feu, sans que je t’approche, m’entrant par les yeux me cuit et brûle jusqu’à la moelle ; pourtant si tu ne me veux laisser mourir de mon mal, baille-moi, ma mie, tout à l’heure cette tant douce médecine ; ou bien, puisque tu me tiens et m’as pris, comme tu le dis, fais de moi ce que tu voudras, et m’écorche à ton plaisir. »
Ainsi fantasiant, j’arrive à la maison, où se trouvoit de fortune, les maîtres étant sortis, Palestre seule occupée à préparer le souper. D’entrée, je l’aborde et lui dis : « Oh, que doucement tu remues, gentille Palestre, tes fesses ensemble et ta poële ! Que telle cuisine est friande, et heureux qui peut tremper un doigt en ta sauce. » Elle (car c’étoit la plus frisque et gente petite femelle !) me repart de bonne grâce : « Fuis, jeune homme, si tu es sage, et si tu veux vivre ; ma poële est ardente et mon brouet bouillant ; que si tu y touches tant seulement, jamais ne guérira de la brûlure. Et n’est physicien tant expert, qui te sçut alléger ce mal, fors moi seule, ce qui est de plus admirable, moi cause de ta douleur. Mais alors me criant merci, tu seras tout le jour après moi. Plus je te ferai souffrir, moins tu me voudras quitter ; non, tu ne t’en iras pas, quand je te jetterois des pierres, ayant éprouvé que c’est de la douceur de mon baume. Tu nourriras ta blessure ; toujours requérant médecine, jamais ne voudras guérison. Qu’as-tu à rire ? Sçais-tu bien que je fais cuisine d’hommes ? qu’autant que j’en prends, je les écorche comme beaux petits lapins, les désosse, les fricasse, n’épargnant foie ni courée ? - Je te crois, lui répondis-je ; car de t’avoir vue seulement, je suis déjà sur la braise. Ton feu, sans que je t’approche, m’entrant par les yeux me cuit et brûle jusqu’à la moelle ; pourtant si tu ne me veux laisser mourir de mon mal, baille-moi, ma mie, tout à l’heure cette tant douce médecine ; ou bien, puisque tu me tiens et m’as pris, comme tu le dis, fais de moi ce que tu voudras, et m’écorche à ton plaisir. »
Adonc, s’éclatant de rire, la bonne gouge me regarde, et de ce moment fut à moi ; nous complotâmes ensemble qu’aussitôt ses maîtres couchés, elle me viendroit trouver, et passeroit avec moi la nuit. Hipparque et sa femme de retour, on soupe après le bain ; bon bain, joyeux devis, allongeoient le repas. Moi, feignant me sentir aggravé de sommeil, je me retire dans ma chambre. Là, je trouvai tout en bel ordre ; le lit de mon valet dehors, près du mien une table, un gobelet, du vin, eau froide, eau chaude ; Palestre, avoit songé à tout ; davantage, mon lit partout jonché de roses, ou entières, ou effeuillées, ou en beaux chapelets arrangées. Voyant toutes choses ainsi prêtes pour le festin, j’attendois mon convive en bonne dévotion.
Elle, sitôt qu’elle eût mis dormir sa maîtresse, s’en vint devers moi sans tarder ; et lors ce fut à nous de boire et de faire carousse de vin ensemble et de baisers ; par où nous étant confortés et préparés au déduit, Palestre se lève et me dit : « Songe, jeune homme, comme je m’appelle, et te souvienne que tu as affaire à Palestre. Or sus, on va voir en cette joute ce que tu sçais faire, et si tu es appris aux armes comme gentil compagnon. - J’accepte ton défi, lui dis-je, et me dure mille ans que nous ne soyons aux prises. Déshabille-toi ; fais tôt. » Lors elle : « C’est moi qui suis le maître d’exercices et qui vais éprouver ton adresse et ta force en divers tours de lutte ; toi fais devoir d’obéir et d’exécuter à point ce que je commanderai. – Commande », lui dis-je. Cependant elle se déshabilloit, et quand elle fut toute nue : « Dépouille-toi, jouvenceau, et te frotte de cette huile. Allons, ferme, bon pied bon œil. Accolle ton adversaire, et d’un croc en jambe le renverse. Bon, bras à bras, corps à corps, flanc contre flanc ; courage, appuye et toujours tiens le dessus. Ça, sous les reins cette main, l’autre sous la cuisse, lève haut, donne la saccade, redouble, serre, sacque, choque, boute, coup sur coup ; point de relâche ; dès que tu sens mollir, étreins : là, là, bellement ; te voilà déjà tout mouillé. »
 Gravure de Van Maele
Gravure de Van Maele
 insi fesois-je, obéissant comme novice à sa parole, et quand j’eus d’elle congé de reposer sur les armes, je lui dis : « Maître, tu vois de quel air je m’y prends, que je n’ai faute d’adresse ni de bonne volonté ; mais, toi qu’il ne te déplaise, tu commandes trop en hâte, et n’a pas besogne faite qui veut suivre ta leçon. » Elle, du revers de sa main, me baille gentiment sur la joue : « Tu fais le raisonneur, indocile écolier ; tu seras châtié si tu faux au commandement ; attention. » Ce disant, elle se lève en pieds ; et après s’être un peu soignée : « Voyons, dit-elle, si tu es champion à l’épreuve en toutes joutes, et combats jusques à outrance. » Puis tombant à genoux sur le lit : « Ce n’étoit que jeu tout à l’heure ce que nous faisions, et pour rompre quelque lance, il ne vaudroit pas la peine d’entrer en champ clos. Maintenant nous allons combattre à fer émoulu : Ça, beau lutteur, nous voilà en présence, attaque-moi vaillamment, prends-moi par le milieu du corps, et frappe, et enfonce : tu me vois nue, ne m’épargne pas : pousse ton épée, retourne-là dans la blessure, fais-la disparaître toute entière ; serre-moi et ne laisse aucun intervalle entre nous deux. Surtout ne te retire pas en arrière avant que tu n’en aies reçu l’ordre ; mais presse ton adversaire, courbe son dos en voûte, profite de sa chute pour te remettre courageusement à l’ouvrage, jusqu’à ce que, vaincu toi-même par la fatigue, tu manques de force et sois tout en nage. » Je partis d’un grand éclat de rire, puis je repris : « Notre maître, il me prend fantaisie de vous prescrire à mon tour quelque petit exercice. Songez à m’obéir ponctuellement. Relevez-vous et asseyez-vous ; avancez une main officieuse, caressez-m’en légèrement et promenez-la sur moi, enlacez-moi bien et faites-moi tomber dans les bras du sommeil. »
insi fesois-je, obéissant comme novice à sa parole, et quand j’eus d’elle congé de reposer sur les armes, je lui dis : « Maître, tu vois de quel air je m’y prends, que je n’ai faute d’adresse ni de bonne volonté ; mais, toi qu’il ne te déplaise, tu commandes trop en hâte, et n’a pas besogne faite qui veut suivre ta leçon. » Elle, du revers de sa main, me baille gentiment sur la joue : « Tu fais le raisonneur, indocile écolier ; tu seras châtié si tu faux au commandement ; attention. » Ce disant, elle se lève en pieds ; et après s’être un peu soignée : « Voyons, dit-elle, si tu es champion à l’épreuve en toutes joutes, et combats jusques à outrance. » Puis tombant à genoux sur le lit : « Ce n’étoit que jeu tout à l’heure ce que nous faisions, et pour rompre quelque lance, il ne vaudroit pas la peine d’entrer en champ clos. Maintenant nous allons combattre à fer émoulu : Ça, beau lutteur, nous voilà en présence, attaque-moi vaillamment, prends-moi par le milieu du corps, et frappe, et enfonce : tu me vois nue, ne m’épargne pas : pousse ton épée, retourne-là dans la blessure, fais-la disparaître toute entière ; serre-moi et ne laisse aucun intervalle entre nous deux. Surtout ne te retire pas en arrière avant que tu n’en aies reçu l’ordre ; mais presse ton adversaire, courbe son dos en voûte, profite de sa chute pour te remettre courageusement à l’ouvrage, jusqu’à ce que, vaincu toi-même par la fatigue, tu manques de force et sois tout en nage. » Je partis d’un grand éclat de rire, puis je repris : « Notre maître, il me prend fantaisie de vous prescrire à mon tour quelque petit exercice. Songez à m’obéir ponctuellement. Relevez-vous et asseyez-vous ; avancez une main officieuse, caressez-m’en légèrement et promenez-la sur moi, enlacez-moi bien et faites-moi tomber dans les bras du sommeil. »
En tels ébats se passa cette nuit, tant doux et plaisants à tous deux, où nous emportâmes le prix des combats nocturnes. Grand plaisir y avois-je de vrai. A peu que je n’en oubliai du tout de mon voyage à Larisse, et le désir qui m’avoit mu de telles armes entreprendre contre cette gente Palestre. Mais à la fin il m’en souvint, et je lui dis : « Ma mie, ma chère, fais que je voye ta maîtresse en ses besognes de sorcellerie, ou prenant quelque étrange forme ; car je meurs d’envie longtemps a de voir semblable prodige ; ou toi-même, si tu t’en mêles, montre-moi quelque œuvre magique et te transforme à mes yeux. Il m’est bien avis que tu dois être du métier, m’ayant changé comme tu as fait et transmué de telle sorte, que moi insensible, farouche ; (ainsi m’appeloient femmes et filles), moi que nulle amour encore n’avoit sçu apprivoiser, me voilà mouton devenu ; tu me mènes à ta fantaisie serf et captif, chose impossible, sinon par enchantement ; et pourtant il faut bien, ma belle, que tu t’en aides quelque peu. - Cesse, me dit-elle, badin, cesse de te mocquer. Et quel charme jamais sçauroit captiver amour, qui lui-même est maître en cet art ? Quant est de moi, je n’y sçais rien. Je te jure, et crois-moi, mon inique souci, par cette chère tête, par ce lit bienheureux témoin de nos plaisirs, oncques je n’appris à lire seulement. Aussi ma maîtresse est par trop jalouse de sa science. Toutefois s’il avient que je te la puisse montrer en quelqu’une de ses métamorphoses, tu la verras, mon doux ami » ; et à tant nous nous couchâmes.
 Quelques jours écoulés, Palestre vient à moi, et me dit que sa maîtresse, le soir même, se devoit changer en oiseau pour aller devers un sien amant. Et moi : « C’est à ce coup, lui dis-je, ah ma chère ! c’est maintenant que tu peux combler mes souhaits. - Ne t’inquiète », me fit-elle. Et le soir venu, elle me mène à la porte de la chambre où couchoient Hipparque et sa femme ; et là me montre entre les ais une petite ouverture, où mettant l’œil, je vis cette femme qui se déshabilloit. Déshabillée nue qu’elle fut, s’approchant de la lampe, elle y brûla deux grains d’encens, et puis ouvrit un gros coffret où étoient force petites fioles ; elle en prit une. Ce qu’il y avoit en cette fiole contenu, au vrai je ne le sçaurois dire. A voir, il me parut comme une sorte d’huile, dont elle se frotta toute des pieds jusqu’à la tête, commençant par le bout des ongles ; et lors voilà de tout son corps plumes qui naissent à foison, puis un bec au lieu de son nez, fort et crochu. Que vous dirai-je ? En moins de rien, elle se fit oiseau de tout point, le plus beau chat-huant qui fût oncques ; puis se voyant bien emplumée, battit des ailes, et puis avec un cri lugubre, par la fenêtre s’envola.
Quelques jours écoulés, Palestre vient à moi, et me dit que sa maîtresse, le soir même, se devoit changer en oiseau pour aller devers un sien amant. Et moi : « C’est à ce coup, lui dis-je, ah ma chère ! c’est maintenant que tu peux combler mes souhaits. - Ne t’inquiète », me fit-elle. Et le soir venu, elle me mène à la porte de la chambre où couchoient Hipparque et sa femme ; et là me montre entre les ais une petite ouverture, où mettant l’œil, je vis cette femme qui se déshabilloit. Déshabillée nue qu’elle fut, s’approchant de la lampe, elle y brûla deux grains d’encens, et puis ouvrit un gros coffret où étoient force petites fioles ; elle en prit une. Ce qu’il y avoit en cette fiole contenu, au vrai je ne le sçaurois dire. A voir, il me parut comme une sorte d’huile, dont elle se frotta toute des pieds jusqu’à la tête, commençant par le bout des ongles ; et lors voilà de tout son corps plumes qui naissent à foison, puis un bec au lieu de son nez, fort et crochu. Que vous dirai-je ? En moins de rien, elle se fit oiseau de tout point, le plus beau chat-huant qui fût oncques ; puis se voyant bien emplumée, battit des ailes, et puis avec un cri lugubre, par la fenêtre s’envola.
Pour moi d’abord je crus rêver, et que c’étoit songe que tout cela, et je me frottois les yeux, ne me pouvant persuader que je ne fusse endormi. A toute force, enfin, voyant qu’il étoit vrai que je ne sommeillois, ni n’en avois envie, je me mis à prier Palestre qu’elle me voulut par cette drogue faire avoir forme d’oiseau et des ailes, et me laissât voler, pour voir si j’aurois en cette guise sens et entendement humain ; elle, me voulant satisfaire, entre dans la chambre, m’apporte une de ces fioles ; et moi de me frotter aussitôt comme j’avois vu faire à cette femme, pour devenir oiseau ; mais hélas ! je devins tout autre chose ; car j’eus, au lieu de plumes, à l’heure même, poil bourru par tout le corps, queue au derrière, oreilles en tête, longues sans mesure, corne dure aux pieds et aux mains. En me regardant, je vis que j’étois un âne. Et si n’avois-je plus ni voix, ni paroles pour me plaindre, mais baissant la tête semblois d’un regard piteux lamenter ma déconvenue et accuser Palestre. Elle de ses deux mains se frappant le visage : « Ah ! malheureuse, qu’ai-je fait ? J’ai pris une fiole pour l’autre, trompée par la ressemblance. Mais ne te chaille, mon amour ; le remède en est aisé. Tu n’as seulement qu’à manger des feuilles de rose, pour dépouiller cette laide forme et me rendre l’amant que j’aime. Aye patience cette nuit, et dès qu’il sera jour demain, je t’en apporterai des roses, dont tu n’auras sitôt goûté, que tu seras remis en ta beauté première. Ce disant, elle me caressoit, me polissoit les oreilles, et me passoit la main sur le dos et partout.
 Gravure de Van Maele
Or avois-je corps de baudet, mais le sens et la pensée tout de même qu’auparavant, fors de ne pouvoir parler. Adonc maudissant en moi-même et l’erreur de Palestre et ma propre sottise, je m’en allais l’oreille basse à l’étable où étoit mon cheval avec le vrai âne de la maison, lesquels aussitôt qu’ils me virent, comme ils crurent que je m’allois mettre à la mangeoire et partager leur pitance, me vouloient festoyer de ruades pour ma bienvenue ; mais je connus leur malice et me retirai en un coin, là où je me déconfortois ; et pensant pleurer, c’étoit braire que je faisois ; et me disois à part moi : « O fatale curiosité ! que seroit-ce, si à cette heure survenoit d’emblée quelque loup ou autre bête sauvage ? Las, sans avoir méfait, tu vas mourir peut-être de la mort des méchants ! » Ainsi raisonnant en moi-même, j’étois loin de prévoir le sort qui m’attendoit.
Gravure de Van Maele
Or avois-je corps de baudet, mais le sens et la pensée tout de même qu’auparavant, fors de ne pouvoir parler. Adonc maudissant en moi-même et l’erreur de Palestre et ma propre sottise, je m’en allais l’oreille basse à l’étable où étoit mon cheval avec le vrai âne de la maison, lesquels aussitôt qu’ils me virent, comme ils crurent que je m’allois mettre à la mangeoire et partager leur pitance, me vouloient festoyer de ruades pour ma bienvenue ; mais je connus leur malice et me retirai en un coin, là où je me déconfortois ; et pensant pleurer, c’étoit braire que je faisois ; et me disois à part moi : « O fatale curiosité ! que seroit-ce, si à cette heure survenoit d’emblée quelque loup ou autre bête sauvage ? Las, sans avoir méfait, tu vas mourir peut-être de la mort des méchants ! » Ainsi raisonnant en moi-même, j’étois loin de prévoir le sort qui m’attendoit.
Sur le tard, que tout étoit muet et coi partout, à l’heure du meilleur somme, un bruit s’entend comme des gens qui, par dehors, eussent voulu percer la muraille ; et de fait on la perçoit ; et tantôt est l’ouverture large assez pour passer un homme ; et un homme entre, et puis un autre, et puis plusieurs autres après, tant que l’étable en étoit pleine ; et avoient tous des épées. De là ils s’en vont dans les chambres, où d’abord ayant lié Hipparque, mon valet et Palestre, ils se mirent à piller et vuider la maison de tout ce qui s’y trouva d’argent, vaisselle et autres biens qu’ils amassèrent dans la cour ; et n’y ayant plus rien à prendre, ils nous bâtèrent et nous sanglèrent, mon cheval et l’autre âne et moi ; et de cet amas de butin, tant que nous en pûmes porter, nous le chargèrent sur le dos ; puis à grands coups de bâtons, nous chassent dans la montagne par des sentiers détournés. De ce que souffrirent dans cette marche mes deux compagnons, je n’en puis que dire ; mais moi accablé sous le faix, et n’ayant de coutume d’aller ainsi déchaux sur ces cailloux pointus, je mourois, je bronchois à chaque pas ; et s’il m’arrivoit de cheoir, l’un me tiroit par le licol, l’autre me doloit de son bâton la croupe et les cuisses. En cette extrémité, je voulus plus d’une fois m’écrier : « O César ! » mais je ne faisois que braire l’ô, et César ne pouvoit venir ; ce qui m’attiroit chaque fois nouvelle tempête de coups, parce qu’ils craignoient que mon braire ne les découvrît. Voyant donc que rien n’y servoit et que même ma plainte empiroit mon marché, je pris le parti de me taire et d’aller ainsi qu’on voudroit.
 l étoit jour, et cheminant par monts et par vaux, nous avions déjà fait longue traite ; on eut soin de nous emmuseler d’un nœud de licol, pour nous garder de perdre temps à brouter de çà et de là, au moyen de quoi nous jeûnions tous trois également pour cette heure. Mais sur le midi que nous vînmes en une métairie de gens affidés à ces ribauds, comme il paroissoit à l’accueil et bonne chère qu’ils firent, les embrassant, les priant de se reposer et leur servant à manger, lors on nous mis nous autres bêtes, dans la paille jusqu’au ventre avec plein ratelier de foin et mesure comble d’avoine, dont mes compagnons se régalèrent, et moi pour lors je demeurai tout seul à jeûner ; car je ne pouvois résoudre encore à goûter de tels mets. Regardant de tous côtés si je ne trouverois plein quelque chose à ma guise, j’aperçois au fond de la cour une manière de potager où étoient de beaux et bons légumes et des rosiers en fleur, à ce qu’il me parut. Adonc sans être vu de personne, ainsi que chacun entendoit préparer le souper, je me dérobe et entre là où je pensois, mangeant de ces roses, redevenir Lucius. Or, ce n’étoient pas de vraies roses, mais bien des roses de laurier qu’on appelle Rhododaphné, triste pâture aux ânes et chevaux ; car ce leur est venin, ce dit-on, qui les fait mourir en peu d’heures. Je sçavois cela et je m’abstins de ces dangereuses fleurs, mais non des raves, laitues, fenouils et autres légumes dont je mangeois à grand appétit, et m’étois déjà fait bon ventre, quand le maître du jardin survint, lequel soit qu’il eut aperçu, ou fut autrement averti, tenoit en main un fort bâton ; ce qu’il en fit n’est pas à demander ; car de l’air d’un prévôt qui prend quelque maraudeur sur le fait, il commença à m’en donner sans regarder où il frappoit, la croupe, l’échine, la tête, battant comme sur seigle vert ; dont à la fin je perdis patience, et lui détachai une ruade si à propos que je le jetai demi mort sur ses choux, et m’enfuyois grand erre du côté de la montagne. Mais le traître, quand il me vit ainsi détaler, s’écria qu’on lâchât les chiens. C’étoient dogues de forte race, et y en avoit bon nombre pour faire la chasse aux ours. Cela me donna à penser ; je retournai crainte de pis, et m’en revint tout courant à l’écurie, dont bien me prit ; car ces mâtins qu’on avoient déjà déchainés, m’alloient étrangler sans remède. Rentrant au logis, je fus reçu à grand renfort de bastonnades et en devois être assommé, n’eût été l’explosion soudaine du mélange, comme je crois, de tous ces herbages dans mon ventre, qui leur éclatant au nez avec grand bruit et infection de méphytique vapeur, mir en fuite tous mes ennemis.
l étoit jour, et cheminant par monts et par vaux, nous avions déjà fait longue traite ; on eut soin de nous emmuseler d’un nœud de licol, pour nous garder de perdre temps à brouter de çà et de là, au moyen de quoi nous jeûnions tous trois également pour cette heure. Mais sur le midi que nous vînmes en une métairie de gens affidés à ces ribauds, comme il paroissoit à l’accueil et bonne chère qu’ils firent, les embrassant, les priant de se reposer et leur servant à manger, lors on nous mis nous autres bêtes, dans la paille jusqu’au ventre avec plein ratelier de foin et mesure comble d’avoine, dont mes compagnons se régalèrent, et moi pour lors je demeurai tout seul à jeûner ; car je ne pouvois résoudre encore à goûter de tels mets. Regardant de tous côtés si je ne trouverois plein quelque chose à ma guise, j’aperçois au fond de la cour une manière de potager où étoient de beaux et bons légumes et des rosiers en fleur, à ce qu’il me parut. Adonc sans être vu de personne, ainsi que chacun entendoit préparer le souper, je me dérobe et entre là où je pensois, mangeant de ces roses, redevenir Lucius. Or, ce n’étoient pas de vraies roses, mais bien des roses de laurier qu’on appelle Rhododaphné, triste pâture aux ânes et chevaux ; car ce leur est venin, ce dit-on, qui les fait mourir en peu d’heures. Je sçavois cela et je m’abstins de ces dangereuses fleurs, mais non des raves, laitues, fenouils et autres légumes dont je mangeois à grand appétit, et m’étois déjà fait bon ventre, quand le maître du jardin survint, lequel soit qu’il eut aperçu, ou fut autrement averti, tenoit en main un fort bâton ; ce qu’il en fit n’est pas à demander ; car de l’air d’un prévôt qui prend quelque maraudeur sur le fait, il commença à m’en donner sans regarder où il frappoit, la croupe, l’échine, la tête, battant comme sur seigle vert ; dont à la fin je perdis patience, et lui détachai une ruade si à propos que je le jetai demi mort sur ses choux, et m’enfuyois grand erre du côté de la montagne. Mais le traître, quand il me vit ainsi détaler, s’écria qu’on lâchât les chiens. C’étoient dogues de forte race, et y en avoit bon nombre pour faire la chasse aux ours. Cela me donna à penser ; je retournai crainte de pis, et m’en revint tout courant à l’écurie, dont bien me prit ; car ces mâtins qu’on avoient déjà déchainés, m’alloient étrangler sans remède. Rentrant au logis, je fus reçu à grand renfort de bastonnades et en devois être assommé, n’eût été l’explosion soudaine du mélange, comme je crois, de tous ces herbages dans mon ventre, qui leur éclatant au nez avec grand bruit et infection de méphytique vapeur, mir en fuite tous mes ennemis.
 Quand il fut heure de partir, on nous rechargea, et alors m’échurent à porter les choses les plus pesantes. Je pris patience toutefois, et ainsi allions par pays ; mais n’en pouvant plus à la fin de fatigue, moulu de coups (aussi que ma corne s’usant, j’en ressentois à chaque pas douleur non pareille), je résolus de me laisser cheoir et ne bouger, me dût-on tuer. Car voici comme je raisonnois : ils se lasseront de me battre, et partageant ma charge aux autres, me laisseront là pour les loups. Car ainsi que je méditois ce projet à part moi, l’autre âne, mon camarade, ayant même dessein possible, s’abat au milieu du chemin, et eux de le battre et de crier pour le faire relever ; mais rien n’y sert ; l’animal reste gisant comme un bloc ; quoi voyant, l’un le prend par la queue, l’autre par les oreilles, et tachoient à le remettre en pieds. Mais en fine fin connoissant qu’ils n’y faisoient œuvre, et qu’ils perdent le temps après un malheureux âne, en grand danger d’être surpris, ils lui ôtent sa charge et nous la font porter à moi et mon cheval, puis lui coupent les jarrets avec leurs coutelas, et le poussent dans un précipice, où roulant à bonds du haut en bas des rochers, notre pauvre compagnon de voyage et d’infortune fit le saut de malemort. Quant à moi, sage à ses dépens, je me résolus de porter vaillamment ma mauvaise fortune et de marcher sans me faire prier, ayant espérance de trouver quelque part des roses qui me rendroient mon premier être, avec ce que j’entendois dire qu’il n’y avoit plus que peu de chemin jusqu’au manoir de ces larrons ; comme de fait, allant d’un bon pas, nous y arrivâmes avant le soir, et entrâmes au logis. Là étoit une vieille assise et un grand feu allumé. Eux premièrement nous déchargèrent, puis serrèrent le butin que nous avions apporté, et disoient à cette vieille : « Que fais-tu, que tu ne prépares tantôt à souper ? - Voire, dit-elle, tout est prêt ; pain frais, vin vieux, et sauvagine que je vous viens d’habiller. » Ils louèrent sa diligence, et devant le feu se dépouillant, se frottèrent, s’oignirent ; et d’un chaudron, qui pendoit à la crémaillère, puisant de l’eau, se la jetoient sur les épaules et sur le corps en guise de bain.
Quand il fut heure de partir, on nous rechargea, et alors m’échurent à porter les choses les plus pesantes. Je pris patience toutefois, et ainsi allions par pays ; mais n’en pouvant plus à la fin de fatigue, moulu de coups (aussi que ma corne s’usant, j’en ressentois à chaque pas douleur non pareille), je résolus de me laisser cheoir et ne bouger, me dût-on tuer. Car voici comme je raisonnois : ils se lasseront de me battre, et partageant ma charge aux autres, me laisseront là pour les loups. Car ainsi que je méditois ce projet à part moi, l’autre âne, mon camarade, ayant même dessein possible, s’abat au milieu du chemin, et eux de le battre et de crier pour le faire relever ; mais rien n’y sert ; l’animal reste gisant comme un bloc ; quoi voyant, l’un le prend par la queue, l’autre par les oreilles, et tachoient à le remettre en pieds. Mais en fine fin connoissant qu’ils n’y faisoient œuvre, et qu’ils perdent le temps après un malheureux âne, en grand danger d’être surpris, ils lui ôtent sa charge et nous la font porter à moi et mon cheval, puis lui coupent les jarrets avec leurs coutelas, et le poussent dans un précipice, où roulant à bonds du haut en bas des rochers, notre pauvre compagnon de voyage et d’infortune fit le saut de malemort. Quant à moi, sage à ses dépens, je me résolus de porter vaillamment ma mauvaise fortune et de marcher sans me faire prier, ayant espérance de trouver quelque part des roses qui me rendroient mon premier être, avec ce que j’entendois dire qu’il n’y avoit plus que peu de chemin jusqu’au manoir de ces larrons ; comme de fait, allant d’un bon pas, nous y arrivâmes avant le soir, et entrâmes au logis. Là étoit une vieille assise et un grand feu allumé. Eux premièrement nous déchargèrent, puis serrèrent le butin que nous avions apporté, et disoient à cette vieille : « Que fais-tu, que tu ne prépares tantôt à souper ? - Voire, dit-elle, tout est prêt ; pain frais, vin vieux, et sauvagine que je vous viens d’habiller. » Ils louèrent sa diligence, et devant le feu se dépouillant, se frottèrent, s’oignirent ; et d’un chaudron, qui pendoit à la crémaillère, puisant de l’eau, se la jetoient sur les épaules et sur le corps en guise de bain.
Or arriva une autre troupe de jeunes gens qui apportoient foison de tous biens, riches bagues, comme on pourroit dire, vases d’or et d’argent, étoffes et brocards de grands prix, joyaux affiquets, vêtements, tant de femme que d’homme ; et ceux-là se joignant aux autres, et ayant serré leur butin, se lavèrent pareillement, puis se mirent à table tous, et entre eux commencèrent tant et si divers propos, que c’étoit merveille de les ouïr. Moi et mon cheval cependant, fûmes par la vieille servis de bel orge à la mangeoire, dont mon camarade pensant avoir meilleure part, s’emplissoit le ventre à grand hâte ; mais je ne lui fis nul tort ; car pendant que la vieille étoit ailleurs empêchée, je mangeois à bon escient du pain de la provision.
Le lendemain, ils s’en allèrent tous à leurs besognes, nous laissant pour garde un jeune homme dont la présence me fâchoit fort ; car la vieille seule ne m’eut sçu empêcher de me sauver. Mais lui d’un regard farouche, fort et roide jeune gars, l’épée à la main, faisoit le guet et tenoit la porte close. Trois jours après, sur la minuit, voici revenir nos larrons, sans or ni argent cette fois, ni autre butin qu’une fille en fleur d’âge et belle à merveille, qui jetoit des cris lamentables. L’ayant fait seoir sur une natte, ils la confortoient de leur mieux, la recommandoient à la vieille, avec ordre d’en prendre soin et ne la jamais quitter. Elle cependant ne vouloit ni manger, ni boire, mais ne faisoit rien que gémir et se désespérer. Ce que voyant, moi de bonne nature, j’en pleurois à mon ratelier, et ne pouvois quasi tenir de sangloter avec cette belle.
Or s’étoient mis les voleurs à boire et banqueter toute la nuit ; mais au point du jour un de ceux qu’ils avoient accoutumé de laisser en aguet sur les routes, leur vint dire qu’un étranger alloit passer ce matin, homme de grosse dépense, menant grand train avec soi et qui montroit être fort riche. Ce qu’entendant, tous se levèrent, s’arment en hâte, nous équipent moi et mon cheval, et nous chassent devant eux. Mois qui sçavoit où l’on alloit, et que nous marchions au combat, je ne voulois pour rien avancer, et fusse demeurer derrière si le bâton ne m’eût contraint d’aller. Venus à l’endroit où devoit passer ce voyageur, on l’attend ; il vient, on l’attaque, on le tue, lui et ses gens ; et de ce qui se trouva de meilleur dans son bagage, on nous charge moi et mon cheval ; le reste demeura caché dans la forêt.

 u retour, ils avoient hâte de s’éloigner, et nous touchoient à grands coups. Ainsi pressé, harcelé, je heurte du pied contre une pierre, pierre non mais rasoir tranchant qui m’ouvrit le sabot jusqu’au vif, dont je souffrois et boitai bas le reste du chemin ; et eux : « Que faisons-nous, disoient-ils, de ce malencontreux animal qui bronche à chaque pas, chet à tout bout de champ et ne sert pas pour ce qu’il mange ? Que ne le jetons-nous pas à la malheure dans quelque fondrière ? - Oui, jetons-le, disoit un autre, et nous débarrassons de cette maudite bête. » Pendant qu’ils me faisoient de la sorte mon procès, moi qui entendois leurs discours, oubliant mon mal aussitôt, je me mis à trotter, et semblois que jamais je n’eusse été si sain. En peu d’heures nous fûmes au logis. On serra ce que nous apportions, puis nos maîtres soupèrent, et après repartirent à nuit close, pour aller quérir dans le bois le demeurant du butin. « Ce malheureux âne, dit un d’eux, est-ce la peine de l’emmener estropié comme le voilà ? Ce que nous ne pourrons sur le cheval charger de ce reste de bagage, portons-le nous-mêmes, c’est le mieux. » Ainsi dit, ainsi fait. Ils vont avec le cheval, éclairés par la lune qui lors étoit en son plein. Moi demeuré seul, je me disois : « Qu’attends-tu, malheureux ? Qu’on régale de ta chair les loups et les corbeaux ? Tu vois le sort qu’on te prépare. Veux-tu pourrir au pied de ces roches, et n’as-tu pas tantôt ouï… ? La nuit te convie, la lune brille ; fuis avant que reviennent tes bourreaux. »
u retour, ils avoient hâte de s’éloigner, et nous touchoient à grands coups. Ainsi pressé, harcelé, je heurte du pied contre une pierre, pierre non mais rasoir tranchant qui m’ouvrit le sabot jusqu’au vif, dont je souffrois et boitai bas le reste du chemin ; et eux : « Que faisons-nous, disoient-ils, de ce malencontreux animal qui bronche à chaque pas, chet à tout bout de champ et ne sert pas pour ce qu’il mange ? Que ne le jetons-nous pas à la malheure dans quelque fondrière ? - Oui, jetons-le, disoit un autre, et nous débarrassons de cette maudite bête. » Pendant qu’ils me faisoient de la sorte mon procès, moi qui entendois leurs discours, oubliant mon mal aussitôt, je me mis à trotter, et semblois que jamais je n’eusse été si sain. En peu d’heures nous fûmes au logis. On serra ce que nous apportions, puis nos maîtres soupèrent, et après repartirent à nuit close, pour aller quérir dans le bois le demeurant du butin. « Ce malheureux âne, dit un d’eux, est-ce la peine de l’emmener estropié comme le voilà ? Ce que nous ne pourrons sur le cheval charger de ce reste de bagage, portons-le nous-mêmes, c’est le mieux. » Ainsi dit, ainsi fait. Ils vont avec le cheval, éclairés par la lune qui lors étoit en son plein. Moi demeuré seul, je me disois : « Qu’attends-tu, malheureux ? Qu’on régale de ta chair les loups et les corbeaux ? Tu vois le sort qu’on te prépare. Veux-tu pourrir au pied de ces roches, et n’as-tu pas tantôt ouï… ? La nuit te convie, la lune brille ; fuis avant que reviennent tes bourreaux. »
Ainsi discourant à part moi, je m’avise que je n’étois point lié. Le licol avec quoi ils me menoient lorsque nous marchions, étoit là pendu à un clou. L’occasion me parut trop belle ; je sors et m’en allois partir, quand la vieille, qui me vit prêt à prendre l’essor, accourt, me saisit par la queue, et tirant à deux mains de toute sa puissance, me pensoit retenir ; mais moi, je fusse mort plutôt que me laisser prendre et me ramener par cette orde vieille, croyant qu’il y allois de mon honneur ; je tirois de ma part et l’entraînois ; et elle de crier et d’appeler à l’aide la jeune prisonnière, laquelle venue en toute hâte, n’eut pas sitôt vu cette Dircé à la queue d’un âne, que prenant son parti en fille de généreux courage elle me saute sur le dos à califourchon, et commence à me talonner. Moi qui n’avois que faire d’éperon, mû de peur pour ma peau et d’envie de m’évader, je cours et gagne au haut, laissant là la vieille étendue de son long, qui ne cessoit de crier ; et la pucelle cependant s’adressoit aux dieux, faisant mille vœux pour son salut. « Si tu me sauves, disoit-elle, et me ramènes à mes parents, ô gentil roussin, tu vivras chez nous sans rien faire, et auras d’avoine par jour un boisseau comble », disoit-elle. Pour faire service à cette belle, autant que pour me dérober au supplice qui m’attendoit, je détalois, n’ayant souvenance de mon mal ; mais arrivés là où le chemin se partageoit en deux, voici fâcheuse rencontre. Les voleurs qui s’en revenoient, nous ayant vus de loin et reconnus au clair de la lune, tout-à-coup nous barrent le chemin : « Holà ! où vas-tu, jouvencelle ?qu’il ne te déplaise, à cette heure ? N’as-tu point peur des esprits ? Viens ça, belle, viens par ici ; on va te ramener tantôt à tes parents », se disant d’un sourire amer, ils me chassent arrière et nous font rebrousser chemin ; mais lors, j’allois boitant, me soutenant à peine et semblois m’être à ce moment ressouvenu de ma blessure. « Tu cloches, disoient-ils, à présent qu’il te faut retourner au logis ; et pour fuir tu avois des ailes, malicieuse bête ! » propos qu’accompagnoient toujours force coups, dont j’eus en peu d’heures une large plaie à la cuisse.
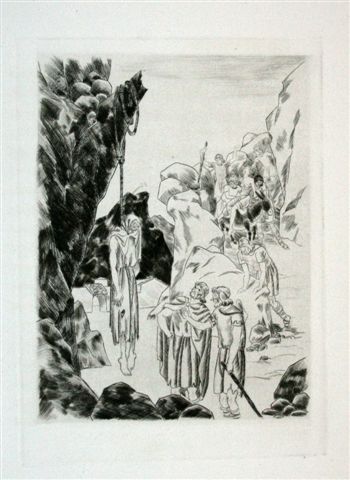 Gravure de Van Maele
De retour nous trouvâmes que la vieille s’étoit pendue au roc, pour la crainte qu’elle eut, ainsi qu’il est à croire, du courroux de ses maîtres, ayant laissé s’enfuir la pucelle avec moi. Ils louèrent son courage et sa fidélité, la détachèrent et la jetèrent la corde au col, comme elle l’étoit, à val des rochers, puis entendirent à manger, ayant lié la fille en un coin ; et tout en buvant parloient d’elle : « Qu’en allons-nous faire, disoit l’un ? et comment la punirons-nous de cette jolie escapade ? - Comment ? dit un autre ; en la jetant après cette vieille. Mais non, ajouta-t-il ; elle a mérité pis pour nous avoir trahis autant qu’en elle étoit ; car afin que vous le sachiez, si cette belle eut sçu tant faire que d’arriver chez ses parents, pas un de nous n’en échappoit ; notre retraite découverte, on eût pris des mesures sûres pour nous exterminer tous. Traitons-la donc en ennemie, qui nous a voulu faire du pis qu’elle pouvoit, et lui rendons la pareille ; que sa mort ne soit pas si prompte ; inventons un supplice qui la fasse longtemps languir dans les tourments et lentement expirer. » Puis ils cherchoient quel genre de mort seroit le plus douloureux ; et un se prit à dire : « Écoutez une rare et nouvelle invention, qui vous plaira, ou je me trompe fort ; l’âne doit mourir, c’est la justice, étant couard et paresseux, et de plus ayant fait le malade pour avoir occasion de s’enfuir avec la donzelle, dont il est fauteur et complice ; égorgeons-le demain sitôt qu’il sera jour, et lui ouvrant le ventre, tirons-en les entrailles ; puis au creux de la bête étripée , logeons cette demoiselle vivante, bien et duement cousue dans la peau du baudet, la tête seulement dehors, afin qu’elle puisse respirer ; ainsi l’un dans l’autre empaquetés, portons-les là-haut sur quelque roche, friande pâture aux vautours. Et considérez, je vous prie, ce que ce sera pour cette tendre et délicate personne, d’habiter au corps d’un âne mort, endurer sur ce roc brûlant toute l’ardeur du soleil, la furie des insectes, la faim toujours croissante, et n’avoir moyen d’abréger de pareils tourments. Je laisse à part ce qu’elle souffrira de l’infection de cette charogne et d’une fourmilière de vers, qui à travers les chairs de l’âne, pénétrant jusques à elle, la déchireront toute vive. »
Gravure de Van Maele
De retour nous trouvâmes que la vieille s’étoit pendue au roc, pour la crainte qu’elle eut, ainsi qu’il est à croire, du courroux de ses maîtres, ayant laissé s’enfuir la pucelle avec moi. Ils louèrent son courage et sa fidélité, la détachèrent et la jetèrent la corde au col, comme elle l’étoit, à val des rochers, puis entendirent à manger, ayant lié la fille en un coin ; et tout en buvant parloient d’elle : « Qu’en allons-nous faire, disoit l’un ? et comment la punirons-nous de cette jolie escapade ? - Comment ? dit un autre ; en la jetant après cette vieille. Mais non, ajouta-t-il ; elle a mérité pis pour nous avoir trahis autant qu’en elle étoit ; car afin que vous le sachiez, si cette belle eut sçu tant faire que d’arriver chez ses parents, pas un de nous n’en échappoit ; notre retraite découverte, on eût pris des mesures sûres pour nous exterminer tous. Traitons-la donc en ennemie, qui nous a voulu faire du pis qu’elle pouvoit, et lui rendons la pareille ; que sa mort ne soit pas si prompte ; inventons un supplice qui la fasse longtemps languir dans les tourments et lentement expirer. » Puis ils cherchoient quel genre de mort seroit le plus douloureux ; et un se prit à dire : « Écoutez une rare et nouvelle invention, qui vous plaira, ou je me trompe fort ; l’âne doit mourir, c’est la justice, étant couard et paresseux, et de plus ayant fait le malade pour avoir occasion de s’enfuir avec la donzelle, dont il est fauteur et complice ; égorgeons-le demain sitôt qu’il sera jour, et lui ouvrant le ventre, tirons-en les entrailles ; puis au creux de la bête étripée , logeons cette demoiselle vivante, bien et duement cousue dans la peau du baudet, la tête seulement dehors, afin qu’elle puisse respirer ; ainsi l’un dans l’autre empaquetés, portons-les là-haut sur quelque roche, friande pâture aux vautours. Et considérez, je vous prie, ce que ce sera pour cette tendre et délicate personne, d’habiter au corps d’un âne mort, endurer sur ce roc brûlant toute l’ardeur du soleil, la furie des insectes, la faim toujours croissante, et n’avoir moyen d’abréger de pareils tourments. Je laisse à part ce qu’elle souffrira de l’infection de cette charogne et d’une fourmilière de vers, qui à travers les chairs de l’âne, pénétrant jusques à elle, la déchireront toute vive. »
Chacun là-dessus s’écria ; chose ne leur parut à tous mieux imaginée. Cependant je me lamentois et déplorois mon triste sort, pesant que j’allois mourir d’une mort si cruelle à la fleur de mes ans, et privé de sépulture, devenir le tombeau de cette malheureuse fille.
Or étoit-il à peine jour ; tout à coup entre avec fracas une troupe de gens armés, qui se saisissent des voleurs et les emmènent garottés au gouverneur de la province. Avec eux de fortune étoit le jeune homme amoureux de cette belle fille, et son fiancé, qui lui-même les avoit conduits jusqu’au repaire de ces larrons, et lors ayant recouvré sa belle, la fit monter sur moi et l’emmena chez lui. Partout où nous passions, les villages entiers accouroient au devant de nous ; et bonnes gens de nous faire fête, et de nous caresser et s’éjouir avec nous de l’heureux événement que j’annonçois de loin par un braire éclatant, faisant office de trompette dans cette espèce de triomphe.
Au logis je fus traité en âne favori de ma jeune maîtresse, qui n’avoit garde d’oublier le compagnon de sa fuite et de sa captivité, avec elle déjà destiné à ce barbare supplice. Par son ordre exprès on me donna foin paille, avoine, orge de quoi saouler un chameau. Mais lors plus que jamais je maudissois Palestre de m’avoir fait âne et non chien ; car je voyois mâtins à toute heure entrer à la cuisine, en emportant force reliefs de belles et bonnes viandes et s’en remplir très bien le ventre, comme chiens sçavent faire étant de noces.
 Gravure de Van Maele
Gravure de Van Maele
 quelque temps de là, sur le récit que fît ma maîtresse à son père des obligations qu’elle m’avoit et du zèle que j’avois montré pour son service, le père me voulant récompenser, commande qu’on me lâchât dans les prés où paissoient ses juments poulinières. Ainsi selon lui, j’allois vivre en toute liesse, n’aillant souci que de paître l’herbe et saillir ces belles cavales ; et pour tout autre âne, à vrai dire, c’eût été contentement. Arrivés que nous fûmes au haras, on me mit avec les juments qui le matin alloient en pâture. Mais il eût été mal, je crois, que la chose passât ainsi sans quelque disgrâce pour moi. Au lieu de me lâcher dehors emmi les prés, selon l’ordre du maître, pour paître en liberté, le chef du haras me laissoit à sa femme Megapole, qui m’attachoit au moulin, et là me faisoit tourner tant que duroit le jour, à moudre son orge et son grain. Encore si j’eusse travaillé pour la maison seulement ! Mais elle prenoit à moudre le bled des voisins, dont elle se payoit en farine, et le tout à mes dépens, trafiquant ainsi des fatigues de mon pauvre col ; et ce qui étoit de pis, c’est que l’orge qu’on lui donnoit pour ma nourriture, elle me le faisoit bien moudre, mais non pas pour moi ; car, de la farine se faisoient beaux gâteaux au four, belles fouaces ; et ne m’en restoit à moi que le son pour mes repas. Que si par hazard on me menoit avec les cavales au pâtis, je me voyois de tous côtés assailli par ces étalons, qui, me croyant là venu pour m’ébattre avec leurs femelles, me poursuivoient à coups de pieds, me déchiroient à belles dents, dont je pensois périr mainte fois victime de la jalousie de messieurs les chevaux. quelque temps de là, sur le récit que fît ma maîtresse à son père des obligations qu’elle m’avoit et du zèle que j’avois montré pour son service, le père me voulant récompenser, commande qu’on me lâchât dans les prés où paissoient ses juments poulinières. Ainsi selon lui, j’allois vivre en toute liesse, n’aillant souci que de paître l’herbe et saillir ces belles cavales ; et pour tout autre âne, à vrai dire, c’eût été contentement. Arrivés que nous fûmes au haras, on me mit avec les juments qui le matin alloient en pâture. Mais il eût été mal, je crois, que la chose passât ainsi sans quelque disgrâce pour moi. Au lieu de me lâcher dehors emmi les prés, selon l’ordre du maître, pour paître en liberté, le chef du haras me laissoit à sa femme Megapole, qui m’attachoit au moulin, et là me faisoit tourner tant que duroit le jour, à moudre son orge et son grain. Encore si j’eusse travaillé pour la maison seulement ! Mais elle prenoit à moudre le bled des voisins, dont elle se payoit en farine, et le tout à mes dépens, trafiquant ainsi des fatigues de mon pauvre col ; et ce qui étoit de pis, c’est que l’orge qu’on lui donnoit pour ma nourriture, elle me le faisoit bien moudre, mais non pas pour moi ; car, de la farine se faisoient beaux gâteaux au four, belles fouaces ; et ne m’en restoit à moi que le son pour mes repas. Que si par hazard on me menoit avec les cavales au pâtis, je me voyois de tous côtés assailli par ces étalons, qui, me croyant là venu pour m’ébattre avec leurs femelles, me poursuivoient à coups de pieds, me déchiroient à belles dents, dont je pensois périr mainte fois victime de la jalousie de messieurs les chevaux.
Telle vie n’étoit pas pour me refaire ; aussi devins-je en peu de temps maigre et décharné, n’ayant ni pâture aux champs, ni repos à la maison ; de plus on me menoit souvent à la montagne et j’en revenois chargé de bois : c’étoit là le comble de mes maux. D’abord il me falloit gravir au haut et au loin des pentes escarpées, des sentiers raboteux, où l’on me donnoit pour conducteur un petit scélérat d’enfant qui me faisoit enrager ; car il ne cessoit de me battre, encore que j’allasse mon grand trot, et me frappoit, non d’un bâton, mais d’une massue pleine de nœuds, et toujours au même endroit, où bientôt, par l’effet des continuels horions, s’ouvrit une plaie vive, sur laquelle le traître alloit frappant toujours. Puis, des charges qu’il me mettoit par fois sur le dos, il n’est d’éléphant qui n’en eût été assommé. Où la descente étoit la plus roide et pénible, c’étoit là qu’il redoublait de coups. Si ma charge mal agencée venoit à pencher d’un côté, en ôter de ce côté pour l’ajouter de l’autre, et rétablir l’équilibre, c’est ce qu’eût fait tout bon ânier ; mais lui, d’une grosse pierre qu’il ramassoit en chemin, faisant le contrepoids à la partie pesante, augmentoit d’autant mon fardeau ; sans compter qu’au pied du coteau, nous traversions à gué une petite rivière ; là où mon brave conducteur, soigneux de ménager sa chaussure, me sautoit en croupe et passoit ainsi sans se mouiller. Que si d’aventure je tombois accablé sous le faix, alors vraiment, alors mon sort étoit à plaindre ; car de descendre pour m’aider à me relever, soit en me soutenant de la main, ou en m’allégeant au besoin d’une part de mon fardeau, le petit maraud n’avoit garde ; mais sans s’émouvoir commençoit à me donner de son bâton sur la tête et sur les oreilles, tant que pour faire cesser cette rage, force m’étoit de me remettre de moi-même en pieds. Mais un beau jour il s’avisa d’une invention pour achever de me désespérer. Ayant fait un bouchon d’épines fort piquantes, bien arrangées en rond, les pointes en dehors, il me la pend sous la queue. Lors à chaque pas que je faisois, ainsi qu’on peut croire, les épines me meurtrissoient de mille piqûres, sans que je les pusse éviter, portant avec moi cette pelote hérissée d’aiguilles qui me battoit au derrière. Si je pensois m’y soustraire en ralentissant mon pas, le bâton m’atteignoit aussitôt ; voulant échapper aux coups, je me déchirois moi-même. Bref, il avoit pris à tache de me faire mourir.
Endurant ainsi chaque jour des maux infinis, une fois je perdis patience, et lui détachai un coup de pied dont il se souvint, et m’en vouloit toujours depuis, ayant ce coup de pied sur le cœur. Or, avint qu’un jour on lui dit d’apporter de quelque hameau, non tant voisin de chez nous, certaines étoupes, à quoi faire il se devoit servir de moi. M’ayant donc mené sur le lieu et chargé d’un tas des ces étoupes liées sur mon dos et affermies d’une double corde étreinte avec un bâton, il me préparoit ce nouveau tour de son métier. Un tison brûlant qu’il avoit au partir dérobé de l’âtre, quand nous fûmes en voie assez loin, il le fourre dans ces étoupes, lesquelles d’abord prenant feu, (et se pouvoit-il autrement ?) me voilà enveloppé de flamme et de fumée, prêt à brûler, si une mare, par bonheur, ne se fût trouvée proche, où je me jetai à corps perdu, et me roulant dans la vase, éteignis cet incendie ; après quoi je repris mon chemin, sûr de n’être pas ars, au moins pour cette fois, n’y ayant moyen de rallumer ces étoupes mouillées, comme il eût bien voulu le bourreau. Mais force lui fut d’y renoncer et de me laisser en vie. Toutefois arrivant au logis, encore trouva-t-il manière de faire entendre que j’étois cause de tout le mal, m’étant, se disoit-il, en passant frotté tout exprès contre un four. Ainsi échappai-je par miracle au feu des étoupes.
Mais ce petit scélérat, acharné à me persécuter, me joua bientôt d’un autre tour pire encore que celui-là. Me ramenant de la montagne avec du bois sur le dos tant que j’en pouvois porter, il vend ma charge à un quidam habitant de ces quartiers ; et revenu à la maison sans un seul fagot, pour s’exempter des étrivières qui ne lui pouvoient faillir, il forge contre moi d’insignes calomnies : « Maître, ce dit-il, à quoi bon nourrir cet âne fainéant qui ne nous rend nul service ? Puis, sçais-tu quelle habitude il a prise depuis peu ? De si loin qu’il voit, femme ou fille en fleur d’âge, belle et jolie, rien ne le sçauroit tenir qu’il ne rompe son lien pour courir après, comme feroit quelqu’amant à la vue de sa maîtresse ; et mon drôle se prend à braire et à la mordre et baiser amoureusement, et pis si l’on n’y donnoit ordre . Vrai, j’ai peur qu’un de ces jour il ne nous fasse quelqu’affaire ; car tout le monde s’en plaint. Quand telle chaleur lui monte, il rompt et renverse tout. A cette heure encore qu’a-t-il fait ? Je le ramenois du bois chargé de bourrées , il vit une femme passer au long de ces champs, et maître âne de ruer et de jeter là sa charge à travers le chemin ; et si gens de là entour ne fussent tôt accourus au secours de la pauvrette, Dieu sçait ce qu’il alloit faire, la tenant déjà sous soi en devoir de besogner d’étrange façon. »
 e que le maître entendant : « Vraiment, dit-il, s’il est ainsi que ce méchant âne ne veuille porter charge ni marcher, et qu’encore il court sus à femmes et filles, tuez-le ; j’en suis content, donnez-en les tripes aux chiens, et la chair aux ouvriers ; et si quelqu’un demande ce qu’il est devenu, nous dirons que les loups l’ont mangé. » Qui fut aise alors ? Ce fut mon coquin de conducteur. Il me vouloit tuer sur le champ ; mais de fortune se trouvoit un bonhomme de nos voisins, qui par un conseil mille fois pire, me sauva la vie néanmoins. « Vous seriez de grands sots, dit-il, de perdre ainsi un animal qui vous peut encore être utile, et cela pour une bagatelle ; car enfin quel est son défaut ? Trop de vigueur le fait courir à toute femelle ; et bien châtrez-le, croyez-moi ; dès qu’il aura perdu cette galante humeur, vous le verrez docile et doux, porter le bât, tourner la meule, et travailler à plaisir. Que si nul de vous s’entend à faire cette opération ; j’ai affaire pour l’heure et ne puis ; mais dans deux jours je reviens ici, et en un tour de main, je vous le rends doux comme un agneau. » e que le maître entendant : « Vraiment, dit-il, s’il est ainsi que ce méchant âne ne veuille porter charge ni marcher, et qu’encore il court sus à femmes et filles, tuez-le ; j’en suis content, donnez-en les tripes aux chiens, et la chair aux ouvriers ; et si quelqu’un demande ce qu’il est devenu, nous dirons que les loups l’ont mangé. » Qui fut aise alors ? Ce fut mon coquin de conducteur. Il me vouloit tuer sur le champ ; mais de fortune se trouvoit un bonhomme de nos voisins, qui par un conseil mille fois pire, me sauva la vie néanmoins. « Vous seriez de grands sots, dit-il, de perdre ainsi un animal qui vous peut encore être utile, et cela pour une bagatelle ; car enfin quel est son défaut ? Trop de vigueur le fait courir à toute femelle ; et bien châtrez-le, croyez-moi ; dès qu’il aura perdu cette galante humeur, vous le verrez docile et doux, porter le bât, tourner la meule, et travailler à plaisir. Que si nul de vous s’entend à faire cette opération ; j’ai affaire pour l’heure et ne puis ; mais dans deux jours je reviens ici, et en un tour de main, je vous le rends doux comme un agneau. »
Cet avis fut approuvé ; chacun demeura d’accord qu’il n’étoit rien plus à propos. Moi je gémissois et me lamentois, pensant que j’allois d’âne encore devenir eunuque, et je ne voulois plus vivre, délibéré de mettre fin à ma triste destinée, ou par m’abstenir de manger, ou en me jetant en bas de quelque rocher, pour conserver l’homme dans l’âne, et mourir du moins tout entier. Mais le même soir à nuit close, nouvelles vinrent du village à la métairie, que le jeune seigneur et sa femme sauvée avec moi des brigands, étoient morts par étrange cas. Se promenant au long du rivage de la mer une après dînée, comme ils s’ébattoient sur la grève, le flot soulevé tout à coup les engloutit ; et ainsi étoient disparus ; commune fin à tous les deux, et d’infortunes et d’amour. Ce qu’entendant, nos gens qui voient la maison sans maîtres, autres que bien anciens et cassés de vieillesse, prennent le parti de ne plus demeurer en servitude ; et faisant main basse sur tout, s’en vont qui de ça, qui de là, chacun avec ce qu’il avoit pu attraper ; là où le maître du haras, mieux que nul autre, fit sa main, aidé de sa femme et de nous, de moi s’entend et des autres bêtes, sur lesquels il mit son butin. Nous partîmes ainsi emportant bagues et biens à foison, et toute nuit marchâmes par chemin de traverse âpres et malaisés ; que s’il me fâchoit de la fatigue, j’étois aise aussi d’échapper à cette maudite opération ; et fîmes tant par nos journées, que nous vînmes en une ville de Macédoine, grande et peuplée, qui s’appelait Beroë. Là nos conducteurs s’arrêtèrent en résolution d’y demeurer et de nous vendre, comme ils firent un jour de foire en plein marché. Le crieur nous fît mettre en rang et nous crioit au plus offrant. Gens s’approchèrent pour nous voir et nous marchander, examinant puis l’un, puis l’autre, et de temps en temps nous levoient le pied, nous regardoient aux dents, nous tâtoient les jambes ; tant qu’à la fin tous furent vendus, hors moi dont personne ne voulut ; et déjà le crieur me renvoyoit, disant : « Celui-là n’a pu trouver marchand » ; quand fortune qui se jouoit à me faire éprouver tant d’accidents divers, m’amena un nouveau maître, non tel que j’eusse pu souhaiter ; car c’étoit un de ces vagabonds, de ces quêteurs qui vont portant par les campagnes la déesse de Syrie, la font mendier de maison en maison, homme déjà sur l’âge, et le plus sale bardache de toute sa confrairie, lequel ayant offert de moi un demi-écu, fut pris au mot, et tout sur-le-champ m’emmena, bien malgré moi qui gémissois d’avoir servir telles gens.
Arrivés que nous fûmes où demeuroit Philèbe (car ainsi avoit-il nom), de loin il s’écria tant qu’il put : « Holà, ho ! fillettes, accourez voir votre nouveau galant ; je vous ai acheté, mesdemoiselles, un vigoureux Cappadocien qui va vous servir à souhait. » Ces demoiselles c’étoient les infâmes débauchés de la séquelle de Philèbe, qui tous sortirent à sa voix, pensant bien trouver quelque fort et roide jeune drôle avec lui. Mais quand ils ne virent qu’un âne conduit à la longe par Philèbe, ils se prirent à le brocarder : « Non, non ce n’est pas là un serviteur pour nous. Bien est-ce ton époux, mignonne, que tu nous amènes ; et où as-tu pris ce beau mari ? N’en serois-tu point déjà grosse ? Bon prou te fasse ; puissiez-vous avoir lignée qui vous ressemble. »
 Le lendemain, ils se mirent à l’ouvrage, comme ils disoient. Premièrement ils habillèrent la déesse et me la chargèrent sur le dos ; puis nous sortîmes de la ville, et allant par pays, arrivâmes en un bourg. Là on m’établit porte-Dieu ; je ne bougeois, tandis que la saint pénaille fesoit rage de danser et de souffler dans ses flûtes avec mille contorsions et grimaces épouvantables, roulant les yeux, tordant le col, la tête renversée, leurs mitres en arrière, ils se tailladoient les bras avec des épées, se coupoient la langue avec les dents, et remplissoient de sang toute la place a l’entour ; ce que voyant, j’entrai dans des peurs non pareilles, doutant qu’il ne fallut aussi du sang de baudet à la déesse. Après s’être ainsi déchiquetés, ils commencèrent leur quête, et recueillirent des assistants d’abord force menue monnoie puis des provisions de toute espèce que ces bonnes gens leur apportoient, qui un baril de vin, qui un sac de farine, du pain, du fromage, des figues, et jusqu’à de l’orge pour l’âne. C’étoient de ces dons qu’ils vivoient et entretenoient la déesse dont j’étois porteur.
Le lendemain, ils se mirent à l’ouvrage, comme ils disoient. Premièrement ils habillèrent la déesse et me la chargèrent sur le dos ; puis nous sortîmes de la ville, et allant par pays, arrivâmes en un bourg. Là on m’établit porte-Dieu ; je ne bougeois, tandis que la saint pénaille fesoit rage de danser et de souffler dans ses flûtes avec mille contorsions et grimaces épouvantables, roulant les yeux, tordant le col, la tête renversée, leurs mitres en arrière, ils se tailladoient les bras avec des épées, se coupoient la langue avec les dents, et remplissoient de sang toute la place a l’entour ; ce que voyant, j’entrai dans des peurs non pareilles, doutant qu’il ne fallut aussi du sang de baudet à la déesse. Après s’être ainsi déchiquetés, ils commencèrent leur quête, et recueillirent des assistants d’abord force menue monnoie puis des provisions de toute espèce que ces bonnes gens leur apportoient, qui un baril de vin, qui un sac de farine, du pain, du fromage, des figues, et jusqu’à de l’orge pour l’âne. C’étoient de ces dons qu’ils vivoient et entretenoient la déesse dont j’étois porteur.
Or, un jour s’étant accointés, dans quelque village, d’un jeune rustre grand et fort, ils l’amènent au logis et se font par lui besogner en la manière accoutumée de tels abominables bardaches. Moi, témoin de ces infamies, je n’y pus tenir davantage, et d’indignation oubliant qui j’étois : « O Jupiter », m’écriai-je. Cela du moins voulois-je dire ; mais mon gosier me trahit et ne produisit qu’un braire qui fut entendu de dehors ; car d’aventure passoient par là quelques paysans, lesquels, ne sçais comment, ayant perdu leur âne, l’alloient cherchant de tous côtés, et n’eurent pas sitôt ouï la tempête de ma voix, que croyant avoir découvert ce dont ils étoient un quête, sans hucher ni parler à âme, ils entrent, et trouvent nos gens empêchés avec ce coquin et virent très bien ce qu’ils faisoient, non sans rire, ainsi qu’on peut croire ; et sortant, s’en vont dire à qui voulut l’entendre, ce qui se passoit là-dedans. Si bien qu’en peu de temps le conte en courut partout. Eux, de honte qu’ils eurent de se voir reconnus pour ce qu’ils étoient, dès la nuit suivante délogent et partent sans bruit. Chemin faisant ils murmuroient, blasphémoient, pestoient contre moi qu’ils appeloient leur dénonciateur, m’accusant d’avoir à dessein et malicieusement révélé le mystère. Je prenois patience, et me serois peu soucié de leurs malédictions ; mais venus à un endroit qui sembloit fort solitaire, ils s’arrêtèrent, et m’ayant ôté la déesse et ma housse et tout, ainsi nu, m’attachent à un arbre, puis de leurs fouets garnis d’osselets, me donnent à tour de bras sur le dos et partout, m’avertissant à chaque coup d’être à l’avenir plus discret, et de tout voir, sans rien dire. Davantage, ils me vouloient tuer, comme celui qui seul avoit causé le scandale, outre la perte non petite que ce leur étoit de quitter sitôt le pays ; et l’eussent fait, sans la déesse qui fort les embarrassoit, étant là gisante à terre ; et si n’y avoit nul moyen de la voiturer autrement. Par quoi force leur fut de me laisser en vie.
 e-là, relevant leur madone, ils se remettent en voie, et le soir, nous vînmes coucher en une maison des champs appartenant à un homme riche qui pour lors s’y trouvoit, et tenant à grand honneur d’avoir chez soi la déesse, nous recueillit, nous logea et nous fit grand’chère. Là, il m’en souvient, je courus un péril extrême, et ce fut que le maître du logis ayant reçu naguère en présent de quelque sien ami un quartier d’âne sauvage, le cuisinier l’avoit pris et le devoit accommoder. Mais il le perdit faute de soin, l’ayant possible laissé dérober à quelque chien ; dont ce pauvre homme craignant les coups, qui ne lui pouvoient faillir, et peut-être pis, résolut de se pendre haut et court, comme il alloit faire, si sa femme, à mon dam, ne l’en eût gardé. « Ne veuille pour cela mourir, ce lui dit-elle, mon ami il y a remède à tout, si tu veux m’en croire. Prends l’âne de ces mendiants, et le menant à l’écart, tu le tueras, l’écorcheras ; puis coupant habilement le quartier gauche de derrière, apporte-le sous ton manteau et le prépares pour le maître en guise de gibier. Ce qui restera du baudet, nous le jetterons quelque part dans ces fondrières ; on croira qu’il s’est perdu et l’on y pensera plus. Vois-tu comme il est gras et refait et meilleur de tout point que l’autre ? Mon homme, goûte ce conseil. - Oui vraiment, femme, tu dis bien : c’est le seul moyen de me soustraire aux fouets et à la torture. » e-là, relevant leur madone, ils se remettent en voie, et le soir, nous vînmes coucher en une maison des champs appartenant à un homme riche qui pour lors s’y trouvoit, et tenant à grand honneur d’avoir chez soi la déesse, nous recueillit, nous logea et nous fit grand’chère. Là, il m’en souvient, je courus un péril extrême, et ce fut que le maître du logis ayant reçu naguère en présent de quelque sien ami un quartier d’âne sauvage, le cuisinier l’avoit pris et le devoit accommoder. Mais il le perdit faute de soin, l’ayant possible laissé dérober à quelque chien ; dont ce pauvre homme craignant les coups, qui ne lui pouvoient faillir, et peut-être pis, résolut de se pendre haut et court, comme il alloit faire, si sa femme, à mon dam, ne l’en eût gardé. « Ne veuille pour cela mourir, ce lui dit-elle, mon ami il y a remède à tout, si tu veux m’en croire. Prends l’âne de ces mendiants, et le menant à l’écart, tu le tueras, l’écorcheras ; puis coupant habilement le quartier gauche de derrière, apporte-le sous ton manteau et le prépares pour le maître en guise de gibier. Ce qui restera du baudet, nous le jetterons quelque part dans ces fondrières ; on croira qu’il s’est perdu et l’on y pensera plus. Vois-tu comme il est gras et refait et meilleur de tout point que l’autre ? Mon homme, goûte ce conseil. - Oui vraiment, femme, tu dis bien : c’est le seul moyen de me soustraire aux fouets et à la torture. »
Pendant que ce bourreau et sa femme tenoient ainsi conseil entre eux, moi qui entendoit leur devis, je compris d’abord où cela alloit aboutir, et vis bien qu’il ne me restoit pour échapper aux couteaux qu’un moyen, c’étoit de m’enfuir comme je fis, rompant mon lien et détalant, après quelques ruades en l’air, du côté de la maison, où j’entrai tout courant jusqu‘en la salle à manger. Là le maître du logis étoit à table avec ses hôtes, les prêtres de la déesse. Entrant de vitesse lancé, je donne au travers des convives et renverse du choc tables et guéridons. Je croyois avoir bien imaginé cela pour me tirer d’affaire, pensant qu’on alloit m’arrêter et mettre quelque part en lieu sûr pour me garder à l’avenir de semblables vivacités ; mais autrement en alla ; car me croyant enragé, ces gens s’arment contre moi de coutelas et d’épieux, et étoient en point pour me faire un mauvais parti, si je ne me fusse sauvé dans une chambre voisine où devoient coucher mes maîtres, et où je ne fus pas plus tôt, qu’on m’y enferma sous clef.
Le lendemain, au plus matin, nous partîmes les mendiants et moi qui toujours portois la déesse, et vînmes en un autre gros bourg non moins habité que le premier, où ils s’avisèrent d’une toute nouvelle invention, qui fut de dire que la déesse ne se pouvoit bonnement loger en maison bourgeoise ; mais qu’il la falloit mettre avec la divinité du lieu. Ces gens bien volontiers, ouvrant le sanctuaire qu’habitoit leur déesse grandement honorée d’eux, y placèrent la nôtre fort révérencieusement. Pour nous, on nous donna logis en une assez pauvre maison. Étant demeurés là quelqu’espace de temps, et voulant ensuite se rendre à la ville voisine, mes maîtres redemandèrent leur déesse aux gens de l’endroit, qui les laissèrent entrer dans le temple et eux-mêmes la reprendre. Après quoi nous nous mîmes en chemin. Or est à sçavoir que ces bons prêtres à l’heure du départ, entrés seuls dans le temple, en avoient dérobé une coupe de fin or qui étoit là pour offrande, et l’emportoient cachée sous l’image de la déesse, de quoi ceux du bourg s’aperçurent quand nous fûmes partis, et envoyèrent gens après nous, qui étant à cheval bien montés, ne mirent guère à nous atteindre, arrêtèrent ces coquins de mendiants, les appelant scélérats, impies et redemandoient le vase sacré, lequel ayant fouillé partout, ils trouvent au giron de la déesse ; si prennent au corps mes larrons convaincus de ce sacrilège, les emmènent liés au bourg, et les retiennent en prison, pour le procès leur être fait ; et la déesse cependant, que j’avois jusque-là portée, fut placée en un autre temple, et la coupe remise en son lieu.
Le jour suivant il fut résolu par publique délibération, qu’on me vendroit et tout ce qui avoit appartenu à ces quêteurs, et je fus vendu à un homme, non du pays, mais d’un village voisin, boulanger de son métier, qui ayant acheté ce même jour au marché dix boisseaux de bled, me les met très bien sur le dos , et me touche ainsi chargé vers le lieu de sa demeure. Quand nous y fûmes arrivés, d’abord on me mène au moulin, où entrant je vis nombre de bêtes, dont j’allois être camarade, et y avoit là plusieurs meules que ces bêtes faisoient tourner ; partout ce n’étoit que farine. Quant à moi, comme nouveau venu qui avois porté tout le jour charge si pesante et cheminé par la traverse, on me laissa reposer pour l’heure ; mais le lendemain, dès qu’il fut jour, on me couvrit la tête d’un sac, puis on m’attache au bras de la meule. Je sçavois, dieu merci, ce que c’étoit de moudre, l’ayant trop bien appris ailleurs ; mais je n’en fis pas semblant, dont mal me prit ; car ces gens-là, me voyant faire le rétif, armés chacun d’un fort bâton, m’entourent que je n’en voyois rien, ayant la tête dans ce sac, et tous à la fois me chargent d’un merveilleux accord, ce qui me fit aussitôt partir et tourner comme un sabot ; par où je connus qu’il est vrai ce que l’on dit communément, que sot est le serf qui attend pour obéir la main du maître.
 Cependant je maigrissois à vue d’œil, et devins bientôt si chétif que le boulanger résolut de se défaire de moi. Si me vend à un jardinier tenant un jardin, non guère grand, qu’il avoit pris à affier. C’étoit-là toute notre besogne. Me voilà donc chaque matin portant des herbes au marché, lesquelles mon maître laissoit aux revendeurs de telles denrées, puis me ramenoit au logis, et la faisoit devoir de fouir, semer, sarcler et arroser planches et carreaux. Je demeurois tout ce temps oisif ; mais je n’en étois rien de plus aise ; au contraire, ma condition me sembloit pire que jamais ; car il étoit hiver alors, et le pauvre homme qui ne gagnoit pas de quoi se vêtir lui-même, n’avoit garde de me couvrir contre le froid ; avec ce que j’étois toujours les pieds dans la boue, fors seulement quand il geloit, qu’à peine me pouvois-je soutenir sur le verglas et la terre dure. Pour vivre, nous n’avions tous deux que quelques méchantes feuilles de chicorée dont les plus amères me demeuroient.
Cependant je maigrissois à vue d’œil, et devins bientôt si chétif que le boulanger résolut de se défaire de moi. Si me vend à un jardinier tenant un jardin, non guère grand, qu’il avoit pris à affier. C’étoit-là toute notre besogne. Me voilà donc chaque matin portant des herbes au marché, lesquelles mon maître laissoit aux revendeurs de telles denrées, puis me ramenoit au logis, et la faisoit devoir de fouir, semer, sarcler et arroser planches et carreaux. Je demeurois tout ce temps oisif ; mais je n’en étois rien de plus aise ; au contraire, ma condition me sembloit pire que jamais ; car il étoit hiver alors, et le pauvre homme qui ne gagnoit pas de quoi se vêtir lui-même, n’avoit garde de me couvrir contre le froid ; avec ce que j’étois toujours les pieds dans la boue, fors seulement quand il geloit, qu’à peine me pouvois-je soutenir sur le verglas et la terre dure. Pour vivre, nous n’avions tous deux que quelques méchantes feuilles de chicorée dont les plus amères me demeuroient.
 Or, une fois entre les autres, nous nous en allions au jardin ; passe un homme de haute taille, soldat ainsi qu’on pouvoit voir à sa soubreveste, lequel commence à nous parler dans le langage des Italiens, et demanda au jardinier où il alloit avec cet âne. A quoi lui bonnement, comme je pense, ne comprenant mot, le regardoit sans rien répondre, ce que l’autre tint à mépris, se fâche et lui donne de son fouet. Le villageois saisit mon homme, d’un croc en jambe le renverse, l’étend au beau milieu du chemin, et le tenant sous soi terrassé, des pieds et des poings le meurtrissoit, et d’une grosse pierre qu’il trouva. Le soldat, du commencement, se défendoit quoiqu’abattu et le menaçoit de son épée, par où l’autre averti de ce qu’il devoit craindre, lui tire l’épée du fourreau et la jette au loin, puis recommençoit à le battre. Le soldat se voyant en ce point, use de finesse, fait le mort. L’autre prit peur, quand il le vit ainsi sans mouvement, et tout effrayé, le laisse là, monte sur moi, pique à la ville, emportant avec soi l’épée. A la ville venu, il avoit un compère, lequel se chargea du jardin ; et lui, de crainte des poursuites, se retire avec moi chez un autre sien compagnon et ami. Le lendemain ayant délibéré entre eux, ce qu’ils trouvèrent de plus expédient pour mon maître, ce fut de le cacher dans un bahut. Quant à moi, on me lie les pieds, et à l’aide d’un bâton passé entre mes jambes, ils me portent à deux en une chambre haute, où l’on me tint enfermé.
Or, une fois entre les autres, nous nous en allions au jardin ; passe un homme de haute taille, soldat ainsi qu’on pouvoit voir à sa soubreveste, lequel commence à nous parler dans le langage des Italiens, et demanda au jardinier où il alloit avec cet âne. A quoi lui bonnement, comme je pense, ne comprenant mot, le regardoit sans rien répondre, ce que l’autre tint à mépris, se fâche et lui donne de son fouet. Le villageois saisit mon homme, d’un croc en jambe le renverse, l’étend au beau milieu du chemin, et le tenant sous soi terrassé, des pieds et des poings le meurtrissoit, et d’une grosse pierre qu’il trouva. Le soldat, du commencement, se défendoit quoiqu’abattu et le menaçoit de son épée, par où l’autre averti de ce qu’il devoit craindre, lui tire l’épée du fourreau et la jette au loin, puis recommençoit à le battre. Le soldat se voyant en ce point, use de finesse, fait le mort. L’autre prit peur, quand il le vit ainsi sans mouvement, et tout effrayé, le laisse là, monte sur moi, pique à la ville, emportant avec soi l’épée. A la ville venu, il avoit un compère, lequel se chargea du jardin ; et lui, de crainte des poursuites, se retire avec moi chez un autre sien compagnon et ami. Le lendemain ayant délibéré entre eux, ce qu’ils trouvèrent de plus expédient pour mon maître, ce fut de le cacher dans un bahut. Quant à moi, on me lie les pieds, et à l’aide d’un bâton passé entre mes jambes, ils me portent à deux en une chambre haute, où l’on me tint enfermé.
 e soldat cependant, sur la route, ainsi que j’entendis depuis, s’étant relevé à toute peine et acheminé vers la ville, moulu de coups et mal en point, fut rencontré de ses camarades, auxquels il raconte tout au long ce qu’il lui étoit avenu, et l’action désespérée de ce maraud de jardinier. Eux aussitôt prennent son parti, et ayant, je ne sçais comment, découvert où nous étions, y viennent accompagnés des magistrats du lieu et de leurs familiers, un desquels entré, fait sortir tout le monde de la maison ; tout le monde dehors, le jardinier ne paroissoit point. Soldats de crier qu’il est dedans, et gens de répondre que non et d’affirmer avec serment n’y avoir céans homme ni bête, âne ni mulet que ce fût. Grand débat là-dessus, grands cris de part et d’autres, grande rumeur dans tout le quartier. Moi qui de mon grenier entendois ce vacarme, toujours sot, et toujours curieux mal à propos, j’avance la tête un bien petit hors de la fenêtre pour regarder en bas, et voir ce que c’étoit. Mais je ne sçus si bien faire, qu’il n’aperçussent mes oreilles, et me voyant, tous s’écrièrent, et par ainsi ceux du logis furent convaincus de mensonge. On entre alors, on fouille partout ; mon maître fut trouvé par les gens de justice, tapi dans son bahut. Ils le prennent, l’emmènent, le mettent en prison, pour son procès lui être fait ; et moi, me dévalant tout ainsi qu’on m’avoit guindé, ils me donnent au soldat pour dédommagement. S’il en fut ri et brocardé, de mon apparition là-haut et de la manière dont j’avois aidé à découvrir mon maître, il n’est jà besoin de le dire ; on en fit le dicton qui court : « Guigne baudet à la fenêtre. » e soldat cependant, sur la route, ainsi que j’entendis depuis, s’étant relevé à toute peine et acheminé vers la ville, moulu de coups et mal en point, fut rencontré de ses camarades, auxquels il raconte tout au long ce qu’il lui étoit avenu, et l’action désespérée de ce maraud de jardinier. Eux aussitôt prennent son parti, et ayant, je ne sçais comment, découvert où nous étions, y viennent accompagnés des magistrats du lieu et de leurs familiers, un desquels entré, fait sortir tout le monde de la maison ; tout le monde dehors, le jardinier ne paroissoit point. Soldats de crier qu’il est dedans, et gens de répondre que non et d’affirmer avec serment n’y avoir céans homme ni bête, âne ni mulet que ce fût. Grand débat là-dessus, grands cris de part et d’autres, grande rumeur dans tout le quartier. Moi qui de mon grenier entendois ce vacarme, toujours sot, et toujours curieux mal à propos, j’avance la tête un bien petit hors de la fenêtre pour regarder en bas, et voir ce que c’étoit. Mais je ne sçus si bien faire, qu’il n’aperçussent mes oreilles, et me voyant, tous s’écrièrent, et par ainsi ceux du logis furent convaincus de mensonge. On entre alors, on fouille partout ; mon maître fut trouvé par les gens de justice, tapi dans son bahut. Ils le prennent, l’emmènent, le mettent en prison, pour son procès lui être fait ; et moi, me dévalant tout ainsi qu’on m’avoit guindé, ils me donnent au soldat pour dédommagement. S’il en fut ri et brocardé, de mon apparition là-haut et de la manière dont j’avois aidé à découvrir mon maître, il n’est jà besoin de le dire ; on en fit le dicton qui court : « Guigne baudet à la fenêtre. »
Ce que devint après cela le pauvre jardinier, je ne sçais. Mais le soldat qu’il avoit battu, me vendit dès le lendemain, et eut de moi cinq beaux écus. Celui qui m’acheta étoit le serviteur d’un homme merveilleusement riche et puissant, faisant sa demeure ordinaire à Thessalonique, ville principale de Macédoine, et voici quel étoit l’office de ce serviteur. Il préparoit les mets particuliers du maître ; et il avoit un frère dans la même maison, esclave comme lui, excellent pâtissier, et de plus panetier, qui faisoit le pain pour leur seigneur. Ces deux vivoient, logeoient ensemble, ainsi que bons frères, toute besogne faisoient en commun, tout profit partageoient entre eux. Ils m’installent en leur logis. Or, par le devoir de leur charge, ils assistoient au repas du maître, et retournant en rapportoient force reliefs de toute façon, l’un de chair et de poisson, l’autre de tartes et de gâteaux, et laissant le tout à ma garde, s’en alloient au bain. Moi qui de si longtemps n’avois goûté pain ni viande, je quittois volontiers mon avoine pour faire honneur aux mets préparés par mes maîtres. Ils furent un temps qu’ils ne s’en donnèrent de garde rentrant au logis, et ne s’avisoient qu’il manquât quelque chose de leur provision, à cause qu’il n’y paroissoit guère sur la quantité, joint que j’usois de discrétion au commencement, et prenois de tout un peu ; mais bientôt j’y fis moins de façon, m’assurant sur leur peu de soin ; je choisissois le plus beau et le meilleur, dont je me bourrois à bon escient, comme s’il n’eût rien coûté, ce qui fit qu’ils s’en aperçurent et entrèrent en soupçon l’un de l’autre, tant qu’ils en vinrent aux injures, s’appelant fripon, voleur, larron des communs profits, et de là en avant, tenoient compte de tout par le menu fort exactement.
 Faisant si bonne chère et vivant à mon aise, j’engraissois et revins bientôt en meilleur point que je n’eusse été, rond, poli, le poil luisant ; c’étoit plaisir de me voir ; dont les deux frères s’étonnèrent, ne pouvant comprendre comment je me portois si bien, quand toute mon avoine restoit dans la mangeoire, sans que jamais j’y touchasse. Ils se doutent du fait ; et pour s’en éclaircir, un beau jour, font semblant de s’en aller au bain ; mais ils demeurèrent derrière la porte en aguet, d’où par quelqu’ouverture ils virent toute ma façon de faire ; car n’ayant nul soupçon de l’embûche, dès que je les sentis dehors, je commençai mon repas. Eux d’abord se prennent à rire, voyant l’étrange parasite qui vivoit à leur dépens ; puis appellent à ce spectacle leurs camarades ; on accourt, et gens de rire et d’éclater, mais si haut et si fort, le long des galeries, que le bruit en vint jusqu’au maître, qui voulut sçavoir ce que c’étoit ; et comme on lui eut dit la chose, il se lève de table, vient, et entr’ouvrant quelque peu l’huis, me voit que j’entamois un morceau de sanglier. Ce fut à lui de rire pour lors. Il entre où j’étois, et croyez qu’il me déplaisoit d’être ainsi surpris par le maître en flagrant délit de gourmandise et de friponnerie, bien qu’il ne s’en fit que gaudir et se tenir les côtés, le bon seigneur. Il voulut que tout sur-le-champ on me conduisit en la salle, où me fut servi sur table de beaucoup et diverses choses que baudets n’ont coutume de manger, telles que potages, viandes, poissons, et ragoûts à toutes sauces. Moi qui voyois que fortune commençoit à sourire, ayant quelqu’espérance aussi, que ce qui d’abord n’étoit que jeu, me pourroit devenir occasion de sortir de cette misère, encore que je vinsse de me bourrer, je me remis à manger comme si j’eusse été à jeûn, au grand plaisir des spectateurs, dont les éclats de rire et les applaudissements remplissoient toute la salle. Quelqu’un même s’avisa de dire : « Que ne lui verse-t-on du vin ? » Ce qui fut aussitôt fait par commandement du maître, et j’en avalai un bon trait sans me faire prier.
Faisant si bonne chère et vivant à mon aise, j’engraissois et revins bientôt en meilleur point que je n’eusse été, rond, poli, le poil luisant ; c’étoit plaisir de me voir ; dont les deux frères s’étonnèrent, ne pouvant comprendre comment je me portois si bien, quand toute mon avoine restoit dans la mangeoire, sans que jamais j’y touchasse. Ils se doutent du fait ; et pour s’en éclaircir, un beau jour, font semblant de s’en aller au bain ; mais ils demeurèrent derrière la porte en aguet, d’où par quelqu’ouverture ils virent toute ma façon de faire ; car n’ayant nul soupçon de l’embûche, dès que je les sentis dehors, je commençai mon repas. Eux d’abord se prennent à rire, voyant l’étrange parasite qui vivoit à leur dépens ; puis appellent à ce spectacle leurs camarades ; on accourt, et gens de rire et d’éclater, mais si haut et si fort, le long des galeries, que le bruit en vint jusqu’au maître, qui voulut sçavoir ce que c’étoit ; et comme on lui eut dit la chose, il se lève de table, vient, et entr’ouvrant quelque peu l’huis, me voit que j’entamois un morceau de sanglier. Ce fut à lui de rire pour lors. Il entre où j’étois, et croyez qu’il me déplaisoit d’être ainsi surpris par le maître en flagrant délit de gourmandise et de friponnerie, bien qu’il ne s’en fit que gaudir et se tenir les côtés, le bon seigneur. Il voulut que tout sur-le-champ on me conduisit en la salle, où me fut servi sur table de beaucoup et diverses choses que baudets n’ont coutume de manger, telles que potages, viandes, poissons, et ragoûts à toutes sauces. Moi qui voyois que fortune commençoit à sourire, ayant quelqu’espérance aussi, que ce qui d’abord n’étoit que jeu, me pourroit devenir occasion de sortir de cette misère, encore que je vinsse de me bourrer, je me remis à manger comme si j’eusse été à jeûn, au grand plaisir des spectateurs, dont les éclats de rire et les applaudissements remplissoient toute la salle. Quelqu’un même s’avisa de dire : « Que ne lui verse-t-on du vin ? » Ce qui fut aussitôt fait par commandement du maître, et j’en avalai un bon trait sans me faire prier.
Le maître donc voyant en moi un animal rare et curieux, fit payer par son trésorier à celui qui m’avoit acheté deux fois ce que je lui coûtois, et me donna pour gouverneur un jeune homme sien affranchi, lequel eut charge de m’instruire et me montrer mille gentillesses pour divertir sa seigneurie, à quoi il n’eut pas grand’peine ; car au moindre mot, je faisois tout ce qu’on vouloit. Il m’apprit à me tenir à table en grave personnage, modestement couché, appuyé sur le coude, à lutter bras à bras et danser avec lui, à faire signe de oui et de non, toutes choses pour lesquelles je n’avois pas besoin de leçons. Cela fit du bruit dans le pays ; on ne parloit que de mes talents et de l’âne de monseigneur, qui mangeoit à table, dansoit, et faisoit cent choses surprenantes. Mais ce qui plus les étonnoit, c’est que je répondois par signe et toujours juste à leur propos ; ayant soif, je demandois à boire, en clignant de l’œil à l’échanson ; dont chacun demeuroit ébahi et faisoit de grandes exclamations, ne se doutant pas qu’il y avoit un homme caché dans cet âne ; et moi je triomphois, et me riois en moi-même de l’erreur de ces gens. On m’apprit aussi les allures les plus commodes pour le maître, quand il me chevauchoit en voyage ou à la promenade. Il n’étoit mulet au pays qui allât l’amble mieux que moi. J’avois un fort bel équipage, et portoit monseigneur en magnifique arroi ; housse de pourpre brodée d’or, mors d’argent à bossettes d’or, têtière garnie de plaques d’or et de grelots, et de sonnettes qui sonnoient fort plaisamment.
 e bon Ménécles, notre maître, n’habitoit pas, comme j’ai dit, d’ordinaire aux champs, mais s’y trouvoit alors pour une telle occasion. Il avoit promis à sa ville un spectacle de gladiateurs, et ces gladiateurs étant prêts, et le temps venu de les montrer, il lui falloit s’en retourner à Thessalonique. Nous partîmes donc un matin. Le maître me montoit quand il se rencontroit quelque pas difficile ou dangereux aux voitures. Or, à notre entrée dans la ville, il n’y eut nul empêché qui n’accourût pour me voir ; car ma renommée me précédoit, et chacun avoit ouï parler des prodiges de mon adresse et de mon intelligence. Mon maître d’abord me fit voir privément chez lui aux personnes de distinction qu’il invitoit exprès à des repas magnifiques, et dans ces grands jours de gala, j’étois la pièce principale dont il festoyoit ses amis. Mais mon gouverneur me montroit à tout venant pour de l’argent, dont il acquis en peu de temps bonne somme de deniers. Il me tenoit en une salle basse, n’ouvrant qu’à ceux qui lui donnoient certain prix pour me voir et être spectateurs de mes faits surprenants. Il n’en venoit guère qui ne m’apportassent à manger de choses et autres, et surtout de ce qui sembloit le moins convenir à un âne. Mangeant donc quasi tout le jour, et soupant chaque soir à table avec la meilleure compagnie, je ne pouvois manquer d’engraisser, comme je fis, et pris bientôt un embonpoint merveilleux, dont avint qu’une dame étrangère fort riche, de figure agréable, pour m’avoir une fois vu dîner, me trouvant le plus bel âne du monde, s’éprit pour moi de telle amour (touchée aussi comme je crois de ma gloire et de mes talents), qu’elle en perdoit le repos, et délibérée à tout prix de satisfaire sa passion, vient à parler à mon gouverneur, lui offrant tout ce qu’il voudroit moyennant qu’elle pût passer avec moi une nuit ; lui, sans autrement se soucier de ce qu’elle pourroit faire de moi, demande tant : marché fut fait, et le soir même, revenant de souper avec le maître, nous la trouvâmes qui m’attendoit. On avoit apporté pour elle force matelas et coussins mols et parfumés, des couvertures et des tapis, dont on nous fit un lit à terre, après quoi, tous ses gens sortirent et se couchèrent comme ils purent devant la porte de la chambre. e bon Ménécles, notre maître, n’habitoit pas, comme j’ai dit, d’ordinaire aux champs, mais s’y trouvoit alors pour une telle occasion. Il avoit promis à sa ville un spectacle de gladiateurs, et ces gladiateurs étant prêts, et le temps venu de les montrer, il lui falloit s’en retourner à Thessalonique. Nous partîmes donc un matin. Le maître me montoit quand il se rencontroit quelque pas difficile ou dangereux aux voitures. Or, à notre entrée dans la ville, il n’y eut nul empêché qui n’accourût pour me voir ; car ma renommée me précédoit, et chacun avoit ouï parler des prodiges de mon adresse et de mon intelligence. Mon maître d’abord me fit voir privément chez lui aux personnes de distinction qu’il invitoit exprès à des repas magnifiques, et dans ces grands jours de gala, j’étois la pièce principale dont il festoyoit ses amis. Mais mon gouverneur me montroit à tout venant pour de l’argent, dont il acquis en peu de temps bonne somme de deniers. Il me tenoit en une salle basse, n’ouvrant qu’à ceux qui lui donnoient certain prix pour me voir et être spectateurs de mes faits surprenants. Il n’en venoit guère qui ne m’apportassent à manger de choses et autres, et surtout de ce qui sembloit le moins convenir à un âne. Mangeant donc quasi tout le jour, et soupant chaque soir à table avec la meilleure compagnie, je ne pouvois manquer d’engraisser, comme je fis, et pris bientôt un embonpoint merveilleux, dont avint qu’une dame étrangère fort riche, de figure agréable, pour m’avoir une fois vu dîner, me trouvant le plus bel âne du monde, s’éprit pour moi de telle amour (touchée aussi comme je crois de ma gloire et de mes talents), qu’elle en perdoit le repos, et délibérée à tout prix de satisfaire sa passion, vient à parler à mon gouverneur, lui offrant tout ce qu’il voudroit moyennant qu’elle pût passer avec moi une nuit ; lui, sans autrement se soucier de ce qu’elle pourroit faire de moi, demande tant : marché fut fait, et le soir même, revenant de souper avec le maître, nous la trouvâmes qui m’attendoit. On avoit apporté pour elle force matelas et coussins mols et parfumés, des couvertures et des tapis, dont on nous fit un lit à terre, après quoi, tous ses gens sortirent et se couchèrent comme ils purent devant la porte de la chambre.
 Elle, restée seule avec moi, d’abord allume une grande lampe dont la lueur éclairoit partout. Puis debout près de cette lampe, s’étant dépouillée toute nue, elle prit de l’essence d’une certaine fiole, et en versa sur moi, s’en oignit, et à moi aussi me parfuma le corps et le museau surtout d’une soëve odeur ; puis me baisa et me caressoit avec pareil langage et toute telle façon comme si j’eusse été son amant. Enfin me prenant par ma longe, elle m’entraîne sur le lit. Je n’avois nulle envie de me faire prier, la voyant belle de tout point, avec ce que la bonne chère, et le vin vieux que je venois de boire, me rendoient assez disposé à la satisfaire ; mai je ne sçavois comment m’y prendre, n’ayant touché femelle depuis ma métamorphose. Une chose encore me troubloit ; j’avois peur de la blesser, voire même de la tuer, qui eût été pour moi une fâcheuse affaire. Il ne me sembloit pas que, fait comme j’étois, femme si gente et délicate me pût recevoir sans en mourir. Mais l’expérience me fit voir que je m’abusois ; car emportée par ses désirs, elle s’étendit sous moi, et de ses bras me tirant à soi et se soulevant du corps, me mit dedans tout entier. Moi pauvre, je craignois encore et me retirois bellement pour la ménager. Mais elle, tant que je reculois, tant plus me serroit et s’enferroit de tout ce que je lui dérobois. A la fin donc pour lui complaire (aussi que je pensois valoir bien, tout âne que j’étois, l’amant de Pasiphaé), la voulant servir à gré, je fus ébahi que je me trouvai petitement outillé pour la demoiselle, et connus que j’avois en tort d’y faire tant de façons. J’eus assez à faire toute nuit à la contenter, tant elle étoit amoureuse et infatigable au déduit. Sitôt qu’il fit jour, elle se leva et partit, étant convenue du même prix pour les autres nuits.
Elle, restée seule avec moi, d’abord allume une grande lampe dont la lueur éclairoit partout. Puis debout près de cette lampe, s’étant dépouillée toute nue, elle prit de l’essence d’une certaine fiole, et en versa sur moi, s’en oignit, et à moi aussi me parfuma le corps et le museau surtout d’une soëve odeur ; puis me baisa et me caressoit avec pareil langage et toute telle façon comme si j’eusse été son amant. Enfin me prenant par ma longe, elle m’entraîne sur le lit. Je n’avois nulle envie de me faire prier, la voyant belle de tout point, avec ce que la bonne chère, et le vin vieux que je venois de boire, me rendoient assez disposé à la satisfaire ; mai je ne sçavois comment m’y prendre, n’ayant touché femelle depuis ma métamorphose. Une chose encore me troubloit ; j’avois peur de la blesser, voire même de la tuer, qui eût été pour moi une fâcheuse affaire. Il ne me sembloit pas que, fait comme j’étois, femme si gente et délicate me pût recevoir sans en mourir. Mais l’expérience me fit voir que je m’abusois ; car emportée par ses désirs, elle s’étendit sous moi, et de ses bras me tirant à soi et se soulevant du corps, me mit dedans tout entier. Moi pauvre, je craignois encore et me retirois bellement pour la ménager. Mais elle, tant que je reculois, tant plus me serroit et s’enferroit de tout ce que je lui dérobois. A la fin donc pour lui complaire (aussi que je pensois valoir bien, tout âne que j’étois, l’amant de Pasiphaé), la voulant servir à gré, je fus ébahi que je me trouvai petitement outillé pour la demoiselle, et connus que j’avois en tort d’y faire tant de façons. J’eus assez à faire toute nuit à la contenter, tant elle étoit amoureuse et infatigable au déduit. Sitôt qu’il fit jour, elle se leva et partit, étant convenue du même prix pour les autres nuits.
Mon gouverneur par tel moyen s’enrichissoit ; et un jour, ainsi que j’étois enfermé avec cette femme, voulant faire sa cour au maître, il va lui dire qu’il avoit quelque chose à lui montrer, un tour de plaisant exercice qu’il m’avoit appris, disoit-il ; lui conte ce que c’étoit et l’amène sans bruit à la porte, d’où, par une fente, il nous vit moi et ma belle couchés ensemble. Cela lui parut singulier. Si pensa d’en tirer parti pour les jeux qu’il devoit donner, croyant faire chose agréable à tous ses concitoyens, s’il les régalait de ce spectacle. Dans ce dessein, il recommande le secret à ses gens, leur fait expresses défenses d’en parler à qui que ce fût ; afin que nous puissions, dit-il, au jour de la fête, le produire sur le théâtre avec quelque femme condamnée, et qu’il la caresse aux yeux de toute l’assemblée qui en verra l’ébattement. Peu après, on m’amène une femme condamnée aux bêtes, à laquelle on dit de me parler et de me toucher, pour d’abord nous accoutumer l’un à l’autre ; et finalement venu le jour des magnificences de mon maître, ils délibèrent et conclurent de me faire paroître au théâtre en cette façon.
 Il y avoit un fort grand lit d’écaille de tortue de l’Inde, tout incrusté d’or, sur lequel on me fit monter et me coucher la femme avec moi ; et puis on nous plaça âne, femme, lit et tout, sur une machine qui à force d’engins et de poulies, en moins de rien nous transporta au beau milieu de l’assemblée. Ce ne fut qu’un cri, quand je parus, de tous les endroits du théâtre, et des applaudissements sans fin. Un couvert somptueux étoit dressé près de nous, où bientôt nous fûmes servis de tout ce dont gens délicats ont accoutumé de dîner ; valets de tous cotés, écuyers pour trancher, beaux jeunes échansons pour nous verser à boire dans des coupes de fin or. D’abord mon gouverneur qui étoit là présent me commanda de manger. Mais moi, je n’en voulus rien faire, de honte que j’avois de tant de monde et d’être à table en plein théâtre ; aussi que j’appréhendois fort qu’il ne saillit de quelque part un ours, un tigre ou autre bête. Comme j’étois en cette peine, quelqu’un passe portant des couronnes et guirlandes de toutes sortes de fleurs, et des roses fraîches parmi, ce qui je ne vis pas plutôt, que je me jette à bas du lit. On crut que j’allois danser ; mais m’approchant de ces fleurs, je commence à choisir entre toutes, et trier une à une les roses les plus belles et en broutois les feuilles à mesure, lorsqu’aux yeux des assistants qui me regardoient étonnés, ma forme extérieure d’animal se va perdant peu à peu, et enfin disparoît du tout ; si bien qu’il n’y avoit plus d’âne, mais à sa place Lucius nu comme quand il vint au monde.
Il y avoit un fort grand lit d’écaille de tortue de l’Inde, tout incrusté d’or, sur lequel on me fit monter et me coucher la femme avec moi ; et puis on nous plaça âne, femme, lit et tout, sur une machine qui à force d’engins et de poulies, en moins de rien nous transporta au beau milieu de l’assemblée. Ce ne fut qu’un cri, quand je parus, de tous les endroits du théâtre, et des applaudissements sans fin. Un couvert somptueux étoit dressé près de nous, où bientôt nous fûmes servis de tout ce dont gens délicats ont accoutumé de dîner ; valets de tous cotés, écuyers pour trancher, beaux jeunes échansons pour nous verser à boire dans des coupes de fin or. D’abord mon gouverneur qui étoit là présent me commanda de manger. Mais moi, je n’en voulus rien faire, de honte que j’avois de tant de monde et d’être à table en plein théâtre ; aussi que j’appréhendois fort qu’il ne saillit de quelque part un ours, un tigre ou autre bête. Comme j’étois en cette peine, quelqu’un passe portant des couronnes et guirlandes de toutes sortes de fleurs, et des roses fraîches parmi, ce qui je ne vis pas plutôt, que je me jette à bas du lit. On crut que j’allois danser ; mais m’approchant de ces fleurs, je commence à choisir entre toutes, et trier une à une les roses les plus belles et en broutois les feuilles à mesure, lorsqu’aux yeux des assistants qui me regardoient étonnés, ma forme extérieure d’animal se va perdant peu à peu, et enfin disparoît du tout ; si bien qu’il n’y avoit plus d’âne, mais à sa place Lucius nu comme quand il vint au monde.
Dire le bruit qui se fit lors, et combien ce changement surprit toute l’assemblée, ne seroit pas chose facile. On s’émeut, chacun parle ainsi qu’il l’entendoit. Les uns me vouloient brûler vif tout sur-le-champ comme sorcier, monstre de qui l’apparition pronostiquoit quelque malheur ; d’autres étoient d’avis de m’interroger d’abord, pour voir ce que je pourrois dire, et décider après cela ce qu’il faudroit faire de moi. Cependant je m’avance vers le préfet de la province, qui d’aventure étoit venu voir l’ébattement des jeux, et lui conte d’en bas au mieux qu’il me fut possible, comme une femme de Thessalie, en me frottant de quelque drogue, m’avoit fait âne devenir, le suppliant de me vouloir garder en prison, tant que par enquête il eût pu sçavoir la vérité du fait ; et le préfet : « Dis-nous un peu ton nom, tes parents, ton pays ; il n’est pas que tu n’ayes quelque part des amis qu’on puisse connoître ? » Je lui répondis, et lui dis : « Mon nom à moi est Lucius, et celui de mon frère Caïus, et avons commun le surnom, tous deux auteurs connus par différents ouvrages ? J’ai écrit des histoires ; il a composé, lui, des vers élégiaques, étant avec cela bon devin ; et sommes de Patras d’Achaïe. » Ce qu’entendant le magistrat : Vraiment, dit-il, tu es né de gens qui, de tout temps, me furent amis et mes bons hôtes, qui plus est, m’ayant reçu et festoyé chez eux en toute courtoisie, et suis témoin que tu dis vrai, te connoissant bien pour leur fils. Cela dit, il se lève, m’embrasse et me mène en son logis, me faisant caresse infinies ; et cependant arrive mon frère qui m’apportoit hardes, argent et tout ce dont j’avois besoin. Le préfet, en pleine assemblée, me déclara franc et libre. J’allai avec mon frère au port, où nous louâmes un bâtiment, et fîmes nos provisions pour retourner au pays.
 Mais avant de partir, je voulus visiter cette dame qui m’avoit tant aimé lorsque j’étois âne, dans la pensée qu’homme elle m’aimeroit davantage encore. J’allai donc chez elle qui fut aise de me voir, prenant plaisir, comme je crois, à la bizarrerie de l’aventure. Elle me convie à souper avec elle et passer la nuit, à quoi volontiers je consentis, ne voulant pas faire le fier ni méconnoître mes amis du temps que j’étois pauvre bête. Je soupe le soir, parfumé, couronné de cette chère fleur qui, après Dieu, m’avoit fait homme, et ainsi faisions chère lie. Le repas fini, quand il fut heure de dormir, je me lève, me déshabille et me présente à elle triomphant, comme certain de lui plaire plus que jamais ainsi fait. Mais quand elle me vit tout homme de la tête aux pieds, et que je n’avois plus rien de l’âne : « Va-t-en, me dit-elle, va, crachant sur moi dépitée ; sors de ma maison, misérable, que je ne t’en fasse chasser. Va coucher où tu voudras. » Et moi tout étonné demandant ce que j’avois fait : « Non, tu ne fus jamais, dit-elle, l’ânon que j’aimai d’amour et avec qui j’ai passé tant de si douces nuits ; ou si c’est toi, que n’en as-tu gardé telles enseignes à quoi je te pusse connoître. C’étoit bien la peine de changer pour te réduire en ce point, et le beau profit pour moi d’avoir un pareil magot au lieu de ce tant plaisant et caressant animal. » Cela dit, elle appelle ses gens qui m’emportent l’un par les pieds, l’autre par les épaules, et me laissent au milieu de la rue, tout nu, tout parfumé, fleuri, en galant qui ne m’attendois guère à coucher cette nuit sur la dure. L’aube commençant à poindre, nu, je m’en cours au vaisseau où je trouvai mon frère, et le fis rire du récit de mon aventure. Nous mîmes à la voile par un vent favorable, et en peu de jours vînmes au pays sans nulle fâcheuse rencontre. Je sacrifiai aux dieux sauveurs et fis les offrandes d’usage pour mon heureux retour, étant à grand’peine recous, non de la gueule du loup, comme on dit, mais de la peau de l’âne où m’avoit emprisonné ma sotte curiosité.
Mais avant de partir, je voulus visiter cette dame qui m’avoit tant aimé lorsque j’étois âne, dans la pensée qu’homme elle m’aimeroit davantage encore. J’allai donc chez elle qui fut aise de me voir, prenant plaisir, comme je crois, à la bizarrerie de l’aventure. Elle me convie à souper avec elle et passer la nuit, à quoi volontiers je consentis, ne voulant pas faire le fier ni méconnoître mes amis du temps que j’étois pauvre bête. Je soupe le soir, parfumé, couronné de cette chère fleur qui, après Dieu, m’avoit fait homme, et ainsi faisions chère lie. Le repas fini, quand il fut heure de dormir, je me lève, me déshabille et me présente à elle triomphant, comme certain de lui plaire plus que jamais ainsi fait. Mais quand elle me vit tout homme de la tête aux pieds, et que je n’avois plus rien de l’âne : « Va-t-en, me dit-elle, va, crachant sur moi dépitée ; sors de ma maison, misérable, que je ne t’en fasse chasser. Va coucher où tu voudras. » Et moi tout étonné demandant ce que j’avois fait : « Non, tu ne fus jamais, dit-elle, l’ânon que j’aimai d’amour et avec qui j’ai passé tant de si douces nuits ; ou si c’est toi, que n’en as-tu gardé telles enseignes à quoi je te pusse connoître. C’étoit bien la peine de changer pour te réduire en ce point, et le beau profit pour moi d’avoir un pareil magot au lieu de ce tant plaisant et caressant animal. » Cela dit, elle appelle ses gens qui m’emportent l’un par les pieds, l’autre par les épaules, et me laissent au milieu de la rue, tout nu, tout parfumé, fleuri, en galant qui ne m’attendois guère à coucher cette nuit sur la dure. L’aube commençant à poindre, nu, je m’en cours au vaisseau où je trouvai mon frère, et le fis rire du récit de mon aventure. Nous mîmes à la voile par un vent favorable, et en peu de jours vînmes au pays sans nulle fâcheuse rencontre. Je sacrifiai aux dieux sauveurs et fis les offrandes d’usage pour mon heureux retour, étant à grand’peine recous, non de la gueule du loup, comme on dit, mais de la peau de l’âne où m’avoit emprisonné ma sotte curiosité.

|










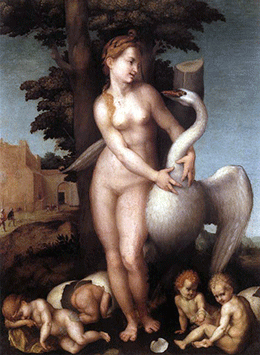
 Préface de la Luciade
Préface de la Luciade




 insi fesois-je, obéissant comme novice à sa parole, et quand j’eus d’elle congé de reposer sur les armes, je lui dis : « Maître, tu vois de quel air je m’y prends, que je n’ai faute d’adresse ni de bonne volonté ; mais, toi qu’il ne te déplaise, tu commandes trop en hâte, et n’a pas besogne faite qui veut suivre ta leçon. » Elle, du revers de sa main, me baille gentiment sur la joue : « Tu fais le raisonneur, indocile écolier ; tu seras châtié si tu faux au commandement ; attention. » Ce disant, elle se lève en pieds ; et après s’être un peu soignée : « Voyons, dit-elle, si tu es champion à l’épreuve en toutes joutes, et combats jusques à outrance. » Puis tombant à genoux sur le lit : « Ce n’étoit que jeu tout à l’heure ce que nous faisions, et pour rompre quelque lance, il ne vaudroit pas la peine d’entrer en champ clos. Maintenant nous allons combattre à fer émoulu : Ça, beau lutteur, nous voilà en présence, attaque-moi vaillamment, prends-moi par le milieu du corps, et frappe, et enfonce : tu me vois nue, ne m’épargne pas : pousse ton épée, retourne-là dans la blessure, fais-la disparaître toute entière ; serre-moi et ne laisse aucun intervalle entre nous deux. Surtout ne te retire pas en arrière avant que tu n’en aies reçu l’ordre ; mais presse ton adversaire, courbe son dos en voûte, profite de sa chute pour te remettre courageusement à l’ouvrage, jusqu’à ce que, vaincu toi-même par la fatigue, tu manques de force et sois tout en nage. » Je partis d’un grand éclat de rire, puis je repris : « Notre maître, il me prend fantaisie de vous prescrire à mon tour quelque petit exercice. Songez à m’obéir ponctuellement. Relevez-vous et asseyez-vous ; avancez une main officieuse, caressez-m’en légèrement et promenez-la sur moi, enlacez-moi bien et faites-moi tomber dans les bras du sommeil. »
insi fesois-je, obéissant comme novice à sa parole, et quand j’eus d’elle congé de reposer sur les armes, je lui dis : « Maître, tu vois de quel air je m’y prends, que je n’ai faute d’adresse ni de bonne volonté ; mais, toi qu’il ne te déplaise, tu commandes trop en hâte, et n’a pas besogne faite qui veut suivre ta leçon. » Elle, du revers de sa main, me baille gentiment sur la joue : « Tu fais le raisonneur, indocile écolier ; tu seras châtié si tu faux au commandement ; attention. » Ce disant, elle se lève en pieds ; et après s’être un peu soignée : « Voyons, dit-elle, si tu es champion à l’épreuve en toutes joutes, et combats jusques à outrance. » Puis tombant à genoux sur le lit : « Ce n’étoit que jeu tout à l’heure ce que nous faisions, et pour rompre quelque lance, il ne vaudroit pas la peine d’entrer en champ clos. Maintenant nous allons combattre à fer émoulu : Ça, beau lutteur, nous voilà en présence, attaque-moi vaillamment, prends-moi par le milieu du corps, et frappe, et enfonce : tu me vois nue, ne m’épargne pas : pousse ton épée, retourne-là dans la blessure, fais-la disparaître toute entière ; serre-moi et ne laisse aucun intervalle entre nous deux. Surtout ne te retire pas en arrière avant que tu n’en aies reçu l’ordre ; mais presse ton adversaire, courbe son dos en voûte, profite de sa chute pour te remettre courageusement à l’ouvrage, jusqu’à ce que, vaincu toi-même par la fatigue, tu manques de force et sois tout en nage. » Je partis d’un grand éclat de rire, puis je repris : « Notre maître, il me prend fantaisie de vous prescrire à mon tour quelque petit exercice. Songez à m’obéir ponctuellement. Relevez-vous et asseyez-vous ; avancez une main officieuse, caressez-m’en légèrement et promenez-la sur moi, enlacez-moi bien et faites-moi tomber dans les bras du sommeil. »

 l étoit jour, et cheminant par monts et par vaux, nous avions déjà fait longue traite ; on eut soin de nous emmuseler d’un nœud de licol, pour nous garder de perdre temps à brouter de çà et de là, au moyen de quoi nous jeûnions tous trois également pour cette heure. Mais sur le midi que nous vînmes en une métairie de gens affidés à ces ribauds, comme il paroissoit à l’accueil et bonne chère qu’ils firent, les embrassant, les priant de se reposer et leur servant à manger, lors on nous mis nous autres bêtes, dans la paille jusqu’au ventre avec plein ratelier de foin et mesure comble d’avoine, dont mes compagnons se régalèrent, et moi pour lors je demeurai tout seul à jeûner ; car je ne pouvois résoudre encore à goûter de tels mets. Regardant de tous côtés si je ne trouverois plein quelque chose à ma guise, j’aperçois au fond de la cour une manière de potager où étoient de beaux et bons légumes et des rosiers en fleur, à ce qu’il me parut. Adonc sans être vu de personne, ainsi que chacun entendoit préparer le souper, je me dérobe et entre là où je pensois, mangeant de ces roses, redevenir Lucius. Or, ce n’étoient pas de vraies roses, mais bien des roses de laurier qu’on appelle Rhododaphné, triste pâture aux ânes et chevaux ; car ce leur est venin, ce dit-on, qui les fait mourir en peu d’heures. Je sçavois cela et je m’abstins de ces dangereuses fleurs, mais non des raves, laitues, fenouils et autres légumes dont je mangeois à grand appétit, et m’étois déjà fait bon ventre, quand le maître du jardin survint, lequel soit qu’il eut aperçu, ou fut autrement averti, tenoit en main un fort bâton ; ce qu’il en fit n’est pas à demander ; car de l’air d’un prévôt qui prend quelque maraudeur sur le fait, il commença à m’en donner sans regarder où il frappoit, la croupe, l’échine, la tête, battant comme sur seigle vert ; dont à la fin je perdis patience, et lui détachai une ruade si à propos que je le jetai demi mort sur ses choux, et m’enfuyois grand erre du côté de la montagne. Mais le traître, quand il me vit ainsi détaler, s’écria qu’on lâchât les chiens. C’étoient dogues de forte race, et y en avoit bon nombre pour faire la chasse aux ours. Cela me donna à penser ; je retournai crainte de pis, et m’en revint tout courant à l’écurie, dont bien me prit ; car ces mâtins qu’on avoient déjà déchainés, m’alloient étrangler sans remède. Rentrant au logis, je fus reçu à grand renfort de bastonnades et en devois être assommé, n’eût été l’explosion soudaine du mélange, comme je crois, de tous ces herbages dans mon ventre, qui leur éclatant au nez avec grand bruit et infection de méphytique vapeur, mir en fuite tous mes ennemis.
l étoit jour, et cheminant par monts et par vaux, nous avions déjà fait longue traite ; on eut soin de nous emmuseler d’un nœud de licol, pour nous garder de perdre temps à brouter de çà et de là, au moyen de quoi nous jeûnions tous trois également pour cette heure. Mais sur le midi que nous vînmes en une métairie de gens affidés à ces ribauds, comme il paroissoit à l’accueil et bonne chère qu’ils firent, les embrassant, les priant de se reposer et leur servant à manger, lors on nous mis nous autres bêtes, dans la paille jusqu’au ventre avec plein ratelier de foin et mesure comble d’avoine, dont mes compagnons se régalèrent, et moi pour lors je demeurai tout seul à jeûner ; car je ne pouvois résoudre encore à goûter de tels mets. Regardant de tous côtés si je ne trouverois plein quelque chose à ma guise, j’aperçois au fond de la cour une manière de potager où étoient de beaux et bons légumes et des rosiers en fleur, à ce qu’il me parut. Adonc sans être vu de personne, ainsi que chacun entendoit préparer le souper, je me dérobe et entre là où je pensois, mangeant de ces roses, redevenir Lucius. Or, ce n’étoient pas de vraies roses, mais bien des roses de laurier qu’on appelle Rhododaphné, triste pâture aux ânes et chevaux ; car ce leur est venin, ce dit-on, qui les fait mourir en peu d’heures. Je sçavois cela et je m’abstins de ces dangereuses fleurs, mais non des raves, laitues, fenouils et autres légumes dont je mangeois à grand appétit, et m’étois déjà fait bon ventre, quand le maître du jardin survint, lequel soit qu’il eut aperçu, ou fut autrement averti, tenoit en main un fort bâton ; ce qu’il en fit n’est pas à demander ; car de l’air d’un prévôt qui prend quelque maraudeur sur le fait, il commença à m’en donner sans regarder où il frappoit, la croupe, l’échine, la tête, battant comme sur seigle vert ; dont à la fin je perdis patience, et lui détachai une ruade si à propos que je le jetai demi mort sur ses choux, et m’enfuyois grand erre du côté de la montagne. Mais le traître, quand il me vit ainsi détaler, s’écria qu’on lâchât les chiens. C’étoient dogues de forte race, et y en avoit bon nombre pour faire la chasse aux ours. Cela me donna à penser ; je retournai crainte de pis, et m’en revint tout courant à l’écurie, dont bien me prit ; car ces mâtins qu’on avoient déjà déchainés, m’alloient étrangler sans remède. Rentrant au logis, je fus reçu à grand renfort de bastonnades et en devois être assommé, n’eût été l’explosion soudaine du mélange, comme je crois, de tous ces herbages dans mon ventre, qui leur éclatant au nez avec grand bruit et infection de méphytique vapeur, mir en fuite tous mes ennemis.

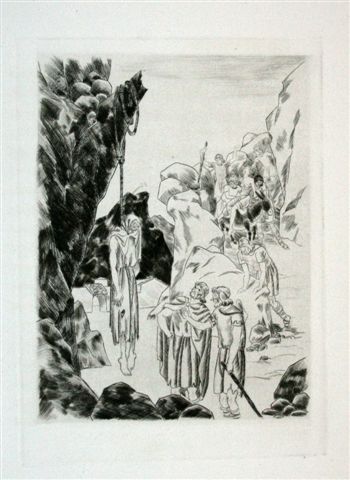

 e que le maître entendant : « Vraiment, dit-il, s’il est ainsi que ce méchant âne ne veuille porter charge ni marcher, et qu’encore il court sus à femmes et filles, tuez-le ; j’en suis content, donnez-en les tripes aux chiens, et la chair aux ouvriers ; et si quelqu’un demande ce qu’il est devenu, nous dirons que les loups l’ont mangé. » Qui fut aise alors ? Ce fut mon coquin de conducteur. Il me vouloit tuer sur le champ ; mais de fortune se trouvoit un bonhomme de nos voisins, qui par un conseil mille fois pire, me sauva la vie néanmoins. « Vous seriez de grands sots, dit-il, de perdre ainsi un animal qui vous peut encore être utile, et cela pour une bagatelle ; car enfin quel est son défaut ? Trop de vigueur le fait courir à toute femelle ; et bien châtrez-le, croyez-moi ; dès qu’il aura perdu cette galante humeur, vous le verrez docile et doux, porter le bât, tourner la meule, et travailler à plaisir. Que si nul de vous s’entend à faire cette opération ; j’ai affaire pour l’heure et ne puis ; mais dans deux jours je reviens ici, et en un tour de main, je vous le rends doux comme un agneau. »
e que le maître entendant : « Vraiment, dit-il, s’il est ainsi que ce méchant âne ne veuille porter charge ni marcher, et qu’encore il court sus à femmes et filles, tuez-le ; j’en suis content, donnez-en les tripes aux chiens, et la chair aux ouvriers ; et si quelqu’un demande ce qu’il est devenu, nous dirons que les loups l’ont mangé. » Qui fut aise alors ? Ce fut mon coquin de conducteur. Il me vouloit tuer sur le champ ; mais de fortune se trouvoit un bonhomme de nos voisins, qui par un conseil mille fois pire, me sauva la vie néanmoins. « Vous seriez de grands sots, dit-il, de perdre ainsi un animal qui vous peut encore être utile, et cela pour une bagatelle ; car enfin quel est son défaut ? Trop de vigueur le fait courir à toute femelle ; et bien châtrez-le, croyez-moi ; dès qu’il aura perdu cette galante humeur, vous le verrez docile et doux, porter le bât, tourner la meule, et travailler à plaisir. Que si nul de vous s’entend à faire cette opération ; j’ai affaire pour l’heure et ne puis ; mais dans deux jours je reviens ici, et en un tour de main, je vous le rends doux comme un agneau. »
 e-là, relevant leur madone, ils se remettent en voie, et le soir, nous vînmes coucher en une maison des champs appartenant à un homme riche qui pour lors s’y trouvoit, et tenant à grand honneur d’avoir chez soi la déesse, nous recueillit, nous logea et nous fit grand’chère. Là, il m’en souvient, je courus un péril extrême, et ce fut que le maître du logis ayant reçu naguère en présent de quelque sien ami un quartier d’âne sauvage, le cuisinier l’avoit pris et le devoit accommoder. Mais il le perdit faute de soin, l’ayant possible laissé dérober à quelque chien ; dont ce pauvre homme craignant les coups, qui ne lui pouvoient faillir, et peut-être pis, résolut de se pendre haut et court, comme il alloit faire, si sa femme, à mon dam, ne l’en eût gardé. « Ne veuille pour cela mourir, ce lui dit-elle, mon ami il y a remède à tout, si tu veux m’en croire. Prends l’âne de ces mendiants, et le menant à l’écart, tu le tueras, l’écorcheras ; puis coupant habilement le quartier gauche de derrière, apporte-le sous ton manteau et le prépares pour le maître en guise de gibier. Ce qui restera du baudet, nous le jetterons quelque part dans ces fondrières ; on croira qu’il s’est perdu et l’on y pensera plus. Vois-tu comme il est gras et refait et meilleur de tout point que l’autre ? Mon homme, goûte ce conseil. - Oui vraiment, femme, tu dis bien : c’est le seul moyen de me soustraire aux fouets et à la torture. »
e-là, relevant leur madone, ils se remettent en voie, et le soir, nous vînmes coucher en une maison des champs appartenant à un homme riche qui pour lors s’y trouvoit, et tenant à grand honneur d’avoir chez soi la déesse, nous recueillit, nous logea et nous fit grand’chère. Là, il m’en souvient, je courus un péril extrême, et ce fut que le maître du logis ayant reçu naguère en présent de quelque sien ami un quartier d’âne sauvage, le cuisinier l’avoit pris et le devoit accommoder. Mais il le perdit faute de soin, l’ayant possible laissé dérober à quelque chien ; dont ce pauvre homme craignant les coups, qui ne lui pouvoient faillir, et peut-être pis, résolut de se pendre haut et court, comme il alloit faire, si sa femme, à mon dam, ne l’en eût gardé. « Ne veuille pour cela mourir, ce lui dit-elle, mon ami il y a remède à tout, si tu veux m’en croire. Prends l’âne de ces mendiants, et le menant à l’écart, tu le tueras, l’écorcheras ; puis coupant habilement le quartier gauche de derrière, apporte-le sous ton manteau et le prépares pour le maître en guise de gibier. Ce qui restera du baudet, nous le jetterons quelque part dans ces fondrières ; on croira qu’il s’est perdu et l’on y pensera plus. Vois-tu comme il est gras et refait et meilleur de tout point que l’autre ? Mon homme, goûte ce conseil. - Oui vraiment, femme, tu dis bien : c’est le seul moyen de me soustraire aux fouets et à la torture. »

 e soldat cependant, sur la route, ainsi que j’entendis depuis, s’étant relevé à toute peine et acheminé vers la ville, moulu de coups et mal en point, fut rencontré de ses camarades, auxquels il raconte tout au long ce qu’il lui étoit avenu, et l’action désespérée de ce maraud de jardinier. Eux aussitôt prennent son parti, et ayant, je ne sçais comment, découvert où nous étions, y viennent accompagnés des magistrats du lieu et de leurs familiers, un desquels entré, fait sortir tout le monde de la maison ; tout le monde dehors, le jardinier ne paroissoit point. Soldats de crier qu’il est dedans, et gens de répondre que non et d’affirmer avec serment n’y avoir céans homme ni bête, âne ni mulet que ce fût. Grand débat là-dessus, grands cris de part et d’autres, grande rumeur dans tout le quartier. Moi qui de mon grenier entendois ce vacarme, toujours sot, et toujours curieux mal à propos, j’avance la tête un bien petit hors de la fenêtre pour regarder en bas, et voir ce que c’étoit. Mais je ne sçus si bien faire, qu’il n’aperçussent mes oreilles, et me voyant, tous s’écrièrent, et par ainsi ceux du logis furent convaincus de mensonge. On entre alors, on fouille partout ; mon maître fut trouvé par les gens de justice, tapi dans son bahut. Ils le prennent, l’emmènent, le mettent en prison, pour son procès lui être fait ; et moi, me dévalant tout ainsi qu’on m’avoit guindé, ils me donnent au soldat pour dédommagement. S’il en fut ri et brocardé, de mon apparition là-haut et de la manière dont j’avois aidé à découvrir mon maître, il n’est jà besoin de le dire ; on en fit le dicton qui court : « Guigne baudet à la fenêtre. »
e soldat cependant, sur la route, ainsi que j’entendis depuis, s’étant relevé à toute peine et acheminé vers la ville, moulu de coups et mal en point, fut rencontré de ses camarades, auxquels il raconte tout au long ce qu’il lui étoit avenu, et l’action désespérée de ce maraud de jardinier. Eux aussitôt prennent son parti, et ayant, je ne sçais comment, découvert où nous étions, y viennent accompagnés des magistrats du lieu et de leurs familiers, un desquels entré, fait sortir tout le monde de la maison ; tout le monde dehors, le jardinier ne paroissoit point. Soldats de crier qu’il est dedans, et gens de répondre que non et d’affirmer avec serment n’y avoir céans homme ni bête, âne ni mulet que ce fût. Grand débat là-dessus, grands cris de part et d’autres, grande rumeur dans tout le quartier. Moi qui de mon grenier entendois ce vacarme, toujours sot, et toujours curieux mal à propos, j’avance la tête un bien petit hors de la fenêtre pour regarder en bas, et voir ce que c’étoit. Mais je ne sçus si bien faire, qu’il n’aperçussent mes oreilles, et me voyant, tous s’écrièrent, et par ainsi ceux du logis furent convaincus de mensonge. On entre alors, on fouille partout ; mon maître fut trouvé par les gens de justice, tapi dans son bahut. Ils le prennent, l’emmènent, le mettent en prison, pour son procès lui être fait ; et moi, me dévalant tout ainsi qu’on m’avoit guindé, ils me donnent au soldat pour dédommagement. S’il en fut ri et brocardé, de mon apparition là-haut et de la manière dont j’avois aidé à découvrir mon maître, il n’est jà besoin de le dire ; on en fit le dicton qui court : « Guigne baudet à la fenêtre. »




